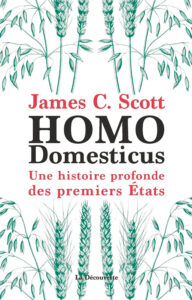 James Scott, anthropologue américain qui se réclame de l’anarchisme, a fait paraître en 2019 un ouvrage au titre intrigant Homo Domesticus (2019)1. Sa thèse ? À l’époque de la domestication des plantes et des animaux, a eu lieu aussi une autre domestication : celle des humains. La domestication concerne les plantes comme les animaux : il s’agit d’adapter un organisme à ses propres besoins. Avant d’avoir été cultivée et adaptée à notre alimentation, la pomme de terre était un légume sauvage, pas plus gros qu’une cerise, très dure et très amère. Les grosses pommes de terre que nous connaissons aujourd’hui sont le produit d’une sélection artificielle, réalisée par les Amérindiens avant la colonisation. Les carottes, les choux, le blé, le riz, et le maïs tels que nous les connaissons ont été aussi transformés pour nos besoins. Il en va de même pour les animaux domestiques. Les chevaux que nous connaissons aujourd’hui descendent tous d’une espèce sauvage domestiquée et transformée en une variété de races façonnées pour un usage précis : chevaux de labour, de transport, de guerre, de course, d’apparat, etc. Au départ, une espèce sauvage. À l’arrivée, une espèce transformée et asservie à une tâche.
James Scott, anthropologue américain qui se réclame de l’anarchisme, a fait paraître en 2019 un ouvrage au titre intrigant Homo Domesticus (2019)1. Sa thèse ? À l’époque de la domestication des plantes et des animaux, a eu lieu aussi une autre domestication : celle des humains. La domestication concerne les plantes comme les animaux : il s’agit d’adapter un organisme à ses propres besoins. Avant d’avoir été cultivée et adaptée à notre alimentation, la pomme de terre était un légume sauvage, pas plus gros qu’une cerise, très dure et très amère. Les grosses pommes de terre que nous connaissons aujourd’hui sont le produit d’une sélection artificielle, réalisée par les Amérindiens avant la colonisation. Les carottes, les choux, le blé, le riz, et le maïs tels que nous les connaissons ont été aussi transformés pour nos besoins. Il en va de même pour les animaux domestiques. Les chevaux que nous connaissons aujourd’hui descendent tous d’une espèce sauvage domestiquée et transformée en une variété de races façonnées pour un usage précis : chevaux de labour, de transport, de guerre, de course, d’apparat, etc. Au départ, une espèce sauvage. À l’arrivée, une espèce transformée et asservie à une tâche.
La face sombre de l’agriculture et de l’élevage
La domestication des plantes et des animaux a eu lieu durant cette longue période que l’on nomme le « néolithique », une période de plusieurs milliers d’années.
Le néolithique a longtemps été vu comme un bond en avant dans le progrès : la production de fruits, de légumes et surtout de céréales permet de nourrir plus de bouches et de stocker des aliments pour l’hiver. Les vaches, les chèvres, les cochons, les poulets et les dindons sont devenus de véritables garde-mangers sur pattes. Et de fait, la population humaine a décuplé à l’époque du néolithique.
Mais depuis quelque temps, ce grand récit progressiste est vu sous un angle nouveau, beaucoup plus sombre. Loin d’être une bénédiction ayant offert aux humains une corne d’abondance, l’agriculture céréalière a aussi été une damnation. La culture des rizières ou des champs de blé impose un travail pénible, bien plus exigeant que la chasse et la cueillette. Songez aux heures courbées pour planter le riz, aux efforts pour labourer, semer, couper puis battre le blé. Le stockage des céréales dans les greniers et silos a attiré les souris et les rats. La concentration de populations et d’animaux dans des espaces limités a été un bouillon de cultures pour les maladies dévastatrices : les rats et souris ont été des vecteurs de la peste et du typhus. Associée au manque d’hygiène, cette concentration a permis la propagation de maladies infectieuses : rougeole, diphtérie, grippe, choléra, tuberculose, etc. La sécurité alimentaire elle-même n’était pas assurée, les récoltes étant soumises aux aléas de la sécheresse, aux inondations, aux maladies, conduisant à de grandes famines.
Au final, l’invention de l’agriculture et de l’élevage n’a pas forcément été une si bonne affaire pour les hommes et les femmes du néolithique.
Reste alors à comprendre pourquoi ils ont adopté un mode de vie aussi coûteux humainement. En fait, ce ne fut pas un choix, répond James Scott. L’adoption de ce nouveau régime de production est comparable à ce qui se passe quand un individu s’engage dans une profession qui se révèle au final plus pénible et moins gratifiante que prévu. Au moment où on se rend compte de son erreur, il est trop tard : il faut payer son loyer, nourrir sa famille, régler ses factures et il n’y a plus de possibilité de faire marche arrière. Les hommes du néolithique se sont emprisonnés eux-mêmes, sans le vouloir.
De fait, si les paysans ont été engagés dans la grande exploitation céréalière, si coûteuse humainement, ce fut surtout, pense James Scott, à leur corps défendant : ils ont été enrôlés de force dans ce système. Le travail des champs avait existé pendant deux millénaires sous forme d’agriculture à petite échelle, combinant chasse, culture de jardin, cueillette et petit élevage. Ces différentes variétés de travaux agricoles sont aujourd’hui bien documentées par les archéologues.
L’agriculture céréalière, celle des champs de blé, des plantations de maïs ou de riz, est une forme d’exploitation agricole très particulière. Elle exige un travail quasi « industriel » : travaux de préparation de la terre (défrichage, irrigation), de plantation, moisson, battage, transport, stockage, etc. Sans parler du partage des terres et de la fabrication des outils (araire, faucille, meules, etc.) Ce pénible labeur (« labeur » vient de « labour ») a sans doute été imposé par des chefs de clans et seigneurs locaux qui se sont emparé des lieux et de leurs ressources et ont asservi et mis au travail les populations locales.
L’invention de l’agriculture et de l’élevage n’a pas forcément été une si bonne affaire.
La grande agriculture céréalière s’est répandue entre 4000 et 2000 ans (soit plusieurs milliers d’années après l’invention de l’agriculture et de l’élevage) dans des régions précises : les bassins des grands fleuves, le Nil (Égypte), le Tigre et l’Euphrate (Mésopotamie), l’Indus (Inde), et le Yang Tsé (Chine). C’est dans ces régions que sont nés les premiers États. Cette coïncidence n’est certainement pas un hasard. Pour James Scott, la culture des céréales a favorisé l’émergence de l’État. Les populations fixées sur un même territoire formaient une force de travail – un bétail humain – que l’on pouvait facilement parquer et contrôler. Les céréales se prêtent facilement au comptage et à l’imposition (payables en sacs de blé, de riz ou de maïs). Les moyens de la coercition étaient multiples : par la force (les captures de guerre fournissaient des esclaves), par la domination économique (attribution d’une terre en échange d’un tribut), et par cette forme d’échange inégale que connaissent bien les systèmes mafieux : je t’offre ma protection (contre les agresseurs extérieurs) en échange de ta soumission (et du paiement d’une taxe).
Mais tout le monde ne fut pas prêt à courber l’échine et à se laisser asservir : beaucoup de paysans ont refusé de se soumettre et ont fui – les impôts, le travail forcé, les obligations militaires et l’humiliation des maîtres – pour aller se réfugier dans les régions reculées : les montagnes et les zones périphériques. James Scott a consacré un précédent livre aux populations paysannes d’Asie du Sud-Est qui ont quitté les zones sous le contrôle de l’État (Zomia, l’art de ne pas être gouverné, 2013).
Finalement, une sorte de sélection sociale se serait opérée entre les populations restées sur place et les populations plus « sauvages » ayant refusé de se soumettre. C’est ainsi que les braves gens auraient été proprement « domestiqués », selon un mode de sélection comparable à la domestication animale. •
- Le titre complet est Homo domesticus, une histoire profonde des premiers États. Le titre original en anglais est Against the grain, 2017 [↩]

Comme nous l’indique Yuval Noah Harari dans Sapiens: « La Révolution agricole fut un piège. » Le blé et les moutons n’avaient plus à se forcer pour combattre les éléments, l’Homo sapiens le faisait dorénavant pour lui. De là apparurent des problèmes médicaux; glissement de disques, arthrite et hernies. C’est vraiment l’homme qui a été domestiqué et la nature en a profité. Pourrions-nous revenir en arrière?
Excellente réflexion qui rejoint des auteurs comme Nietzsche, Marx, Heidegger, Annah Harendt, Onfray… et cela nous amène à la supériorité des peuples nomades sur les peuples sédentaires (Mongols, Parthes, Huns etc..). Actuellement notre concentration dans les grandes villes nous rend plus faciles à « gérer ».
La sélection s est affinée : système éducatif, concours, examens, confréries communautés,
églises, algorithmes etc… le tri des humains continue
Il faut choisir, se reposer ou être libre, disait Thucidide il y a près de 2500 ans , et Murray Bookchin l’a repris. Étienne de la Boetie cherchait en écrivant son « traité de la servitude volontaire » d’où était venu ce « grand malencontre ». La réponse est en suspend.