Il est, non loin de la côte est des États-Unis, une communauté d’une centaine de personnes du nom de Twin Oaks. Depuis plus d’un demi-siècle maintenant, celle-ci s’applique à faire vivre au quotidien des principes étrangers au reste de la société américaine, à commencer par le partage quasi-intégral de la propriété matérielle et le polyamour[1]. Régulièrement interrogés sur le fonctionnement de leur petite bulle anarcho-communiste, les membres répondent invariablement que Twin Oaks n’est certainement pas un paradis. Depuis là où ils vivent, en revanche, il est plus aisé qu’ailleurs d’apercevoir les rives de l’utopie. Une telle réponse fleure à l’évidence le paradoxe. Au sens le plus ordinaire, l’utopie n’est-elle pas un pays purement imaginaire, un non-lieu (ou-topia) pour reprendre le terme exact de l’humaniste anglais Thomas More qui forge le mot en 1516 ? Si la réponse est assurément positive, il faut se souvenir que, dès 1518 (à l’occasion d’une nouvelle édition de l’ouvrage à Bâle), son auteur utilise également le terme d’eu-topia pour signifier que l’île d’utopie est aussi un pays où il fait bon vivre.
La difficulté à assigner une signification simple et univoque au terme d’utopie croît davantage encore à la lecture du livre éponyme de T. More. En dépit des multiples précautions, circonvolutions et autres antiphrases qui obligent parfois à lire le texte entre les lignes, il ne fait aucun doute que l’Utopie doit aussi, et peut-être d’abord, se lire comme une critique féroce de la société anglaise du début du XVIème siècle et de son souverain Henri VIII. Devenu un genre littéraire à part entière, l’utopie est tout cela à la fois : une projection vers l’avant de rêves éveillés, l’expression collective d’un désir de bonne vie et, en creux, la révélation acide d’un monde réel difficile à supporter.
Au XIXème siècle, les sociologues élargissent encore davantage l’éventail des significations. L’utopie sert à certains d’entre eux/elles de fiction heuristique destinée à mieux comprendre la réalité sociale. L’objectif est de mesurer ce qui sépare le monde existant d’une construction mentale échafaudée de toutes pièces. C’est ainsi que procède par exemple Charlotte Perkins Gilman, romancière et sociologue américaine et autrice de Herland (1915), l’une des toutes premières utopies féministes. En imaginant une société exclusivement peuplée de femmes, C. Perkins Gilman met en évidence, par effet de contraste, les multiples formes de dominations qui, en ce début de XXème siècle, modèlent les relations entre les sexes.
C’est encore un autre fil que je voudrais tirer ici : celui des « utopies concrètes », pour utiliser une expression du philosophe allemand Ernst Bloch[2]. Il va s’agir plus exactement de considérer les multiples bricolages organisationnels qui, hier comme aujourd’hui, ont été effectués par des femmes et des hommes décidés à implanter dans la chair du social, puis à les faire vivre concrètement et durablement, des principes de vie collective qui dérogent aux canons de la grande société. L’espoir, dans tous les cas, est de faire des rêves éveillés un moyen de transformation du monde.

Les racines des rêves éveillés puisent profond dans le sous-sol de notre histoire occidentale. Dans La République, qui a été rédigé entre 384 et 377 avant J.C., Platon décrit déjà les conditions d’une Cité parfaite. Mais le véritable coup d’envoi revient à T. More. Sa fiction est mise à disposition du public lettré en une période où les explorations au long cours confirment l’existence, au-delà des mers, de terres dont les institutions et les mœurs diffèrent de celles du continent européen. Le récit participe alors d’une double rupture, religieuse et politique[3]. Il est contemporain d’abord de la Réforme initiée en 1717 par Luther, un moine augustin allemand, qui, en affichant ses 95 thèses, bouscule la doxa et les pratiques de l’Église catholique. Il fait contrepoint par ailleurs aux thèses du florentin Nicolas Machiavel qui magnifient la puissance souveraine de l’État, organe politique par excellence qui n’a cure de Dieu ou de toute autre entité transcendante. Dans tous les cas, pour gouverner le monde, la main est donnée à ceux qui habitent ici-bas.
Les utopies ne rencontrent néanmoins le succès qu’à partir des Lumières. Les romans politiques, récits de voyage et autres songes éveillés mettant alors en scène des sociétés de nulle part prennent pour modèle des configurations sociales supposées avoir fait leurs preuves dans le passé, qu’il s’agisse de groupements religieux (communautés juives, monastères chrétiens, sectes protestantes, réductions jésuites) ou non (communautés taisibles de laboureurs, indiens de l’Orénoque…). Quand, à force de sillonner les mers à la découverte de nouveaux continents, les hommes prennent conscience de la finitude du globe, l’utopie se fait ensuite uchronie. A la manière de Louis-Vincent Mercier, pionnier de ce nouveau type d’aventure, le temps devient la nouvelle Terra incognita. En 1771, l’homme de lettres français publie L’An 2040, fiction qui projette son héros dans le futur, dans un Paris enfin épuré de tous les vices sociaux et politiques anciens.
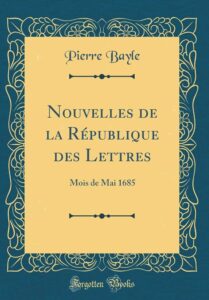
Utopie et socialisme
Le XIXème siècle consacre pour sa part l’avènement des premières utopies concrètes. Sur fond de métamorphoses économiques et d’instabilités politiques, les envies d’autrement se multiplient. Certains ouvriers couchent nuitamment sur le papier des idées de réorganisation sociale, tel le menuisier saint-simonien Gauny qui forge un modèle d’économie cénobitique fondé sur l’ascèse. Sa conviction première est que vivre de peu est le meilleur des moyens pour s’émanciper des vicissitudes qui contraignent les classes populaires[5].
Parce qu’ils font école et que leurs idées inspirent des expérimentations concrètes, d’autres hommes contribuent avec davantage de visibilité à la promotion de nouveaux rêves éveillés. Il en est ainsi de Robert Owen qui prend la tête, dès l’âge de vingt ans, d’une filature de près de 500 ouvriers avant, grâce à un beau mariage, d’acquérir une usine à New Lanarck (Écosse) avec le concours de ses associés manchestériens. Là, durant une vingtaine d’année, l’auteur d’Une nouvelle conception de la société (1813) expérimente ses idées sur l’éducation et le travail. Convaincu qu’il est possible de modeler les idées et les pratiques de n’importe communauté humaine, il multiplie les innovations : réduction du temps de travail et bonification des conditions matérielles des activités productives, amélioration de l’hygiène, mise à disposition de logements et de commerces au bénéfice des ouvriers, invention d’une pédagogie nouvelle, etc.
En 1824, R. Owen part pour les États-Unis où il rachète la colonie d’Harmony à une secte protestante. L’industriel inaugure, avec le nom de New Harmony, un nouveau village communautaire de quelque 800 personnes qu’il entend faire vivre conformément à sa doctrine. Mais c’est l’échec. New Harmony cesse de fonctionner en 1827 en raison de de difficultés économiques et de fortes tensions internes. Adoubées ou non par R. Owen, une dizaine d’autres expériences de communauté coopérative inspirées par une même philosophie voient le jour dans les années qui suivent en Angleterre et aux États-Unis.
En France, en plus des saint-simoniens, Étienne Cabet et Charles Fourier sont les deux principaux hérauts des temps futurs. Tous deux préconisent une nouvelle organisation du monde social qu’ils proposent de mettre en œuvre dans des espaces de vie communautaires. Mais les règles de vie qu’ils imaginent dans leurs ouvrages respectifs diffèrent fortement. É. Cabet, qui signe Voyage en Icarie en 1840, façonne une utopie exigeante qu’il associe aux principes d’égalité, de fraternité et de liberté. Un prospectus de 1855 vante ainsi les mérites des colonies qui appliqueront ce schéma : « un icarien ne peut être propriétaire de rien, ni de son logement, ni de ses vêtements, ni de ses outils, ni de ses armes, etc. Il a l’usage ou la jouissance de ce que la Communauté lui confie ; mais il n’en a pas la propriété ; cette propriété ne peut appartenir qu’à la Communauté entre les mains de qui elle est une propriété indivise, sociale et commune ».
Le message séduit davantage les ouvriers que les membres classes fortunées, moins enclines au partage. De toutes les manières, la conjoncture politique ne se prête pas à application immédiate. Peu avant la révolution de 1848, persécuté par le pouvoir monarchiste, É. Cabet appelle ses disciples à fuir l’Europe. Une poignée d’entre eux gagne alors les États-Unis où ils fondent plusieurs communautés successives qui rassembleront, au total, plusieurs milliers de membres. É. Cabet prend en main son petit monde lorsqu’il arrive à son tour outre-Atlantique au début de l’année 1849. Il dirige d’une main de fer les colons installés à Nauvoo dans l’Illinois. Démis de ses fonctions en mai 1856 en raison de ses excès tyranniques, É. Cabet s’exile avec quelques fidèles à Saint-Louis où il meurt rapidement. La dernière des Icaries s’éteindra quant à elle en 1895.
Une pluralité d’expérimentations sociétaires
Le destin des utopies concrètes dont C. Fourier imagine les plans est un peu différent. Plutôt bien accueilli par un public de bourgeois (avocats, médecins, ingénieurs, chefs d’entreprise…), la philosophie que ce fils de commerçant lyonnais distille dans ses différents ouvrages, depuis la Théorie des quatre mouvements et des destinées générales (1808) jusqu’au Nouveau monde industriel et sociétaire (1829), veut s’affranchir de l’utopie. Ce type de rêverie métaphysique, affirme-t-il, est impuissante et dangereuse. En réalité, le rapport de C. Fourier à l’utopie est fondamentalement ambivalent. Lui-même, en effet, fait preuve d’une créativité débridée. Ses écrits fourmillent de considérations inattendues sur l’eau de mer promise à la transformation en limonade, sur les rapports sexuels que les planètes entretiennent entre elles, sur l’apparition futurs de nouvelles races animales comme les anti-baleines que les hommes sauront utiliser pour remorquer leurs bateaux, sur la hiérarchie des 80 types de cocuage qu’il recense avec soin…
En s’appuyant sur une grammaire des passions, le philosophe bisontin imagine également des façons de travailler, d’éduquer, d’aimer qui s’affranchissent des codes de son époque et qui indiquent des voies nouvelles que, bien des décennies après lui, de nouveaux aventuriers de l’utopie chercheront à appliquer en pratique. C. Fourier est déterminé, le premier, à ce que ses vues prennent rapidement consistance. Chaque jour, dix ans durant, il rentre à son domicile à midi, dans l’espoir qu’un philanthrope vienne lui remettre le million nécessaire à la construction de la première communauté inspirée de ses écrits. A cette fin, dès le Traité de l’Association Domestique-Agricole (1822), il fournit des indications précises concernant ses projets de « phalanstère ». Union d’une taille variant entre 1 800 et 2 000 sociétaires rassemblés pour vivre et travailler sur un mode harmonieux, le phalanstère (ou manoir de la phalange) est un palais comparable à celui de Versailles, à ceci près qu’il est bien plus grand, qu’il peut accueillir plusieurs centaines de familles et qu’il est doté de rues-galeries qui permettent de circuler en son sein sans jamais risquer les injures du mauvais temps. Planté au cœur d’une campagne radieuse, à proximité immédiate d’une rivière, le phalanstère cumule par ailleurs tous les attributs fonctionnels nécessaires à la vie communautaire : cuisine et réfectoire, salles d’études et de réunions publiques, bibliothèque, caravansérail, magasins, étables, greniers, tour d’ordre, cours, jardins… et, bien sûr, des ateliers où les sociétaires, enfants compris, multiplient les occupations selon un principe de travail varié et attrayant.
De son vivant, C. Fourier n’a l’opportunité de connaître qu’une seule expérimentation phalanstérienne, à Condé-sur-Vesgre (Seine-et-Oise). La première pierre de cette colonie sociétaire est posée en 1833, après que deux Condéens (un agronome et un médecin) ont mis à la disposition des fouriéristes un terrain de 460 hectares. Dans les premiers jours du projet, C. Fourier accepte d’être le directeur du futur phalanstère. Mais les difficultés matérielles qui s’accumulent immédiatement, et le sentiment de ne pouvoir peser sur l’évolution du projet, ont vite raison de son engagement. Le maître rêveur jette l’éponge dès 1833. La Société Anonyme qui servait de support juridique est dissoute trois ans plus tard. Sous l’égide de fouriéristes, divers projets de colonie se concrétisent sur les mêmes lieux, mais sans jamais aboutir au palais que C. Fourier appelait de ses vœux.
D’autres expérimentations d’inspirations sociétaires prennent vie ensuite : la colonie sociétaire de Cîteaux (en Côte d’or) (1841-1847), la colonie de Boussac (dans la Creuse) (1844), l’Union agricole d’Afrique de Saint-Denis-du Sig (en Algérie) (1845), la Société agricole et industrielle de Beauregard à Vienne (dans l’Isère) (1861-1914) ainsi que la Maison rurale d’expérimentation sociétaire à Ry (en Seine-Maritime) (1866-1885)[6]. Aucune de ces phalanstères, ou assimilés, n’atteint cependant la renommée du Familistère de Guise qui, après près plus d’un siècle d’existence et de nombreuses vicissitudes internes ne rend les armes qu’en 1968.

Les États-Unis, terres d’utopies concrètes
Pour des raisons historiques, les États-Unis ont tôt et davantage accueilli d’utopies concrètes que le vieux monde continental[8]. Les premiers à s’établir sont les Shakers. Entre 1787 et 1826, ceux-ci fondent à eux seuls une vingtaine de communautés. D’autres sectes protestantes suivent le mouvement : les quakers, les baptistes, les anabaptistes et les huttérites, les adventistes, les méthodistes, les unitariens, les perfectionnistes et les mormons. D’autres communautés complètent la palette des sensibilités (le transcendantalisme, l’universalisme, le théosophisme, le judaïsme), auxquelles on peut aussi associer les groupes qui revendiquent une philosophie swedenborgienne[9].
A partir des années 1840, le fouriérisme, dont les principales idées ont été importées par Albert Brisbane, entre dans le jeu. Le mouvement est lancé par un groupe de transcendantalistes décidé à fonder une « nouvelle Jérusalem ». Sous la gouverne de Georges et Sophia Ripley, il prend possession de bâtiments fermiers sur un terrain situé dans le Massachussetts. Brook Farm est le nom immédiatement donné à la communauté. Là, chaque jour, les quelques 90 membres qui auront l’occasion d’y séjourner œuvrent au service de l’entreprise collective en faisant vivre des principes étrangers à la grande société : partage égalitaire des profits, libre choix des travaux en fonction des goûts et des envies, variété des tâches, valorisation similaire d’une heure du travail (le taux de rémunération horaire est le même pour un gamin qui trait une vache que pour un ancien professeur de Harvard qui enseigne à l’école de la communauté). Personne n’est donc affecté à une tâche ou à un statut en raison de son âge, de son sexe ou de son origine sociale. Pour éviter l’ennui, il faut parfois trouver des astuces, comme relier un livre à chaque planche à repasser afin qu’il soit aisément possible de le lire tout en maniant le fer. En 1844, la communauté se convertit au fouriérisme et participe activement au développement de l’associationnisme, le mouvement qui, aux États-Unis, porte les idées de l’utopiste français. En 1847, un incendie dans la communauté met fin à l’aventure.
Les historiens estiment que, à la suite de Brook Farm, près d’une quarantaine de phalanstères ont été érigés sur le sol américain, principalement durant la décennie 1840 et essentiellement au Nord-Est du pays. Parce que, vue d’Europe, les États-Unis font figure de terre vierge, les fouriéristes français emboîtent le pas aux owénistes et traversent l’Atlantique à leur tour. 350 s’établissent à Réunion (Texas), sous la direction de Victor Considerant. Mais des conditions de vie trop rudes et les incompétences du chef de la communauté ont assez rapidement raison de l’expérience, qui s’achève en 1858. Tous les phalanstères nord-américains ne subissent pas les mêmes difficultés. Certains brillent plus encore par leur leur capacité à imaginer des modes d’organisations et des dispositifs appelés à déteindre ultérieurement sur le reste de la société. On peut penser en particulier à la communauté d’Oneida qui, dans un esprit mêlant puritanisme et fouriérisme, associe le travail libre et l’amour libre, promesses dont les années 1960 tenteront à leur tour de mettre en pratique. C’est aussi à Oneida qu’un homme met au point des appareils destinés à alléger le travail domestique, le rince-serpillère (mop wringler) et le lave pommes de terre (potatoes washer) en l’occurrence. Concrétisation d’un rapport plus égalitaire et plus agréable au travail, sape des conventions sexuelles traditionnelles au profit du polyamour, imagination et construction d’appareils qui ont conquis ensuite de nombreux foyers : même si, par d’autres aspects, Oneida n’est pas vierge de tout reproche majeur, le bilan d’Oneida montre à quel point l’utopie n’est pas qu’un rêve accroché aux nuages de l’abstraction sociale. A preuve, après des mues successives, la communauté prend finalement les atours d’une entreprise classique qui ne ferme définitivement ses portes qu’en 2000.
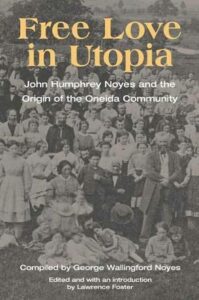
Contre-culture et reviviscences utopistes depuis la fin des années 1960
La veine utopiste ne se tarit pas après que l’owénisme, le cabétisme, le fouriérisme et quelques-unes encore de leurs cousines en « isme »[10] ont cessé d’inspirer les prophètes du changement. Dans les deux pays, la cause libertaire[11] reprend rapidement le flambeau. Outre-Atlantique, c’est dans un tel esprit que Josiah Warren fonde Utopia dès 1847 puis Modern Times en 1851. D’autres expérimentations de facture anarchiste prennent ensuite le relais, concurremment à des communautés gagnées à la cause de l’abolitionnisme, du féminisme, de l’amour libre, du végétarisme… Sur le continent européen, les noms sont multiples – colonies libertaires, milieux libres, phalanstères anarchistes… – pour désigner ces collectifs qui, au tournant du XIXème et du XXème siècle, mettent aussi en pratique le partage de la propriété et des richesses, l’ascétisme, le végétarisme, le naturisme, l’amour libre… Pour ne citer que les plus connus, Monte Verità (1900-1922), le milieu libre de Vaux (1902-1907) ou encore la colonie libertaire d’Aiglemont (1903-1909) ont laissé quelques traces qui témoignent de la radicalité des modes de vie adoptés par celles et ceux qui, bien avant que notre société ne soit gagnée à la cause écologiste, décident de vivre autrement, en faisant notamment le choix d’une communion quotidienne avec la nature.
Un même esprit innerve l’action des jeunes gens cultivés des classes moyennes qui, dans l’élan contestataire des années 1960 et 1970, décident à leur tour de se retirer de la vie urbaine. Décidés à bâtir un contre-monde susceptible de faire pièce à un capitalisme patriarcal dont s’accommode une société de consommation alors en plein essor, ils font eux aussi le choix des communautés utopiques. En France, ces ruraux d’un nouveau genre élisent principalement domicile dans le sud de la France. Le pic du mouvement est atteint en 1972 : durant l’été, 30 à 40 000 personnes se réfugient à l’écart du grand monde pour tenter de redonner du sens à leur travail, d’en finir avec la course aux dépenses superfétatoires, d’éradiquer toutes les formes de pouvoir ou encore de mettre à mal la famille nucléaire[12].
Dès l’hiver 1972, le reflux se fait sentir : 5 000 communards seulement sont restés sur place. L’élan se brise d’autant plus rapidement que des conditions matérielles parfois extrêmement rudes et des relations fortement teintées d’autoritarisme masculin transforment ces expérimentations rurales en cauchemars dystopiques[13]. A l’heure des hippies, les collectifs ont aussi du mal à se faire accepter par un monde rural peu en phase avec des valeurs et des pratiques dont il n’est pas coutumier. Pour toutes ces raisons, le mouvement s’épuise aussi rapidement qu’il s’était manifesté. En réalité, la flamme utopique vacille mais ne s’éteint pas. Pour se jouer de l’usure du temps, certaines communautés font non seulement preuve de résistance, de réalisme et de créativité, mais, à la façon de Longo Maï, elles savent même gagner en extension. Dans les décennies les années 1970, de nouvelles migrations néo-rurales viennent aussi par vagues régulières redonner du lustre au phénomène communautaire[14].
Sans patron et sans salaire, Longo Maï expérimente depuis ses débuts un communisme pratique fondé sur le partage des biens et des revenus, la production autogérée de richesses à l’échelle locale et le soutien financier de bonnes âmes acquises au projet. La répartition égalitaire des tâches, la variété des travaux effectués au quotidien, la reconnaissance de toutes les activités utiles au collectif (une heure passée en cuisine a autant de valeur qu’une heure passée aux champs), des fêtes à dates régulières… sont autant de principes qui structurent une vie collective qui ne s’est jamais exonérée d’engagements politiques aussi bien régionaux, nationaux qu’internationaux. Loin d’espérer vivre heureux parce que cachés, les « longos » ne font pas qu’agir sur le monde en participant à de multiples luttes sociales. Dès 1976, ils décident d’étendre leur domaine en ramifiant leur présence. Longo Maï est ainsi devenu un réseau de coopératives dont le siège est basé en Suisse. Il possède à son actif six communautés implantées en France, deux en Suisse, une en Autriche, une en Allemagne, une en Ukraine, une en Roumanie et une dernière, enfin, au Costa Rica. 
Communautés utopique et anarchie à l’heure du numérique
Au tournant des années 1960 et 1970, l’embrasement communautaire est plus spectaculaire et plus durable encore aux États-Unis qu’en France[15]. Forte d’un tel héritage, la Federation for intentional communities (FIC) aide aujourd’hui celles et ceux qui le souhaitent à s’établir voire à fonder de petits mondes utopiques. Aux côtés et avec l’appui des quelques mille communautés actuellement recensées au pays de l’Oncle Sam, elle veut contribuer plus généralement au changement social d’un pays qui est loin d’en avoir fini encore avec la violence, l’inégalité et l’exploitation.
Au début des années 2000, les hackerspaces et autres Fablabs (ateliers de fabrication) sont nés sur ces mêmes terres d’outre-Atlantique. Version communautaire jusqu’alors inédite, ces lieux voient d’abord le jour sur les deux côtes des États-Unis avant de fleurir un peu partout sur l’ensemble du territoire, puis de conquérir le reste du monde. Ces espaces d’un genre nouveau, que l’on classe parfois dans la famille des tiers-lieux, encouragent la pratique du Do it Yourself et du Do it with Others en mettant à disposition du plus grand nombre des outils et des machines, depuis le marteau jusqu’à l’ordinateur en passant par la fraiseuse et la découpeuse au laser. Ouverts, du moins en principe, à tous et à tout moment, ils n’exigent pas un engagement aussi radical et aussi complet que les communautés utopiques traditionnelles. Ces collectifs sont en revanche des foyers d’innovations technologiques de premier ordre. L’impression en trois dimensions y a été très tôt testée, tout comme les premiers mariages entre l’informatique et la biologie.
En Californie du Nord, dans et aux abords de la Silicon Valley en particulier, les hackerspaces les plus novateurs ont directement hérité des référents libertaires qui avait innervé les communautés intentionnelles d’antan. Baignés de culture informatique, ces hackerspaces sont des lieux de concentration militants. Celles et ceux qui les fréquentent les plus assidûment défendent la liberté absolue de l’information, se refusent à accorder la moindre confiance aux autorités institutionnelles, rejettent vivement toutes les formes de discrimination (raciale, sociale, de genre…) et, last but not least, clament haut et fort que l’art et la technique sont des moyens privilégiés pour changer la vie.

Les membres de ces communautés sont souvent de jeunes gens issus des classes moyennes supérieures, des hommes en majorité, au fait des derniers développements technologiques et informatiques. Rétifs à la subordination, ils bricolent en s’associant avec qui ils veulent et comme ils l’entendent. Et quand le collectif doit prendre une décision, c’est toujours par consensus, et non au moyen du vote. Une telle grammaire du travail est de nature, du moins l’espèrent-ils, à convaincre le plus grand nombre d’apprendre à hacker, soit à utiliser des matériaux ou des règles à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été conçues. Le but n’est pas détruire mais au contraire de bonifier, aussi bien des programmes informatiques, des vêtements, de la nourriture, de la musique que la société tout entière[16].
L’investigation sociologique de tels espaces montre que tous ne répondent pas avec la même intensité aux exigences radicales susceptible de les instituer en petits mondes anarchistes, au sens le plus noble du terme. A l’instar de la maison d’édition O’Reilly et de la chaîne TechShop, des entités économiques traditionnelles ont su rapidement tirer un profit monétaire de l’appétence actuelles en faveur de ces lieux où l’on se fait maker pour créer, fabriquer, apprendre et transmettre[17]. La mode récente des « entreprises libérées » doit aussi à la philosophie d’inspiration libertaire des premiers hackers. L’objectif n’est plus tant cependant d’en finir avec les bureaucraties qui, pour emprunter les mots de K. Marx, enveloppent comme un filet le corps de la société en en bouchant tous les pores, mais de trouver un moyen, typiquement libertarien, de revivifier un capitalisme en pleine métamorphose aujourd’hui.
Ne nous y trompons pas pour autant. Les utopies, celles d’hier comme d’aujourd’hui, ne sont pas condamnées à faire le jeu des forces sociales dominantes qui auraient, toujours et partout, la capacité de retourner à leur avantage les critiques et les innovations pratiques qui leurs sont opposées. Comme en témoigne toute l’œuvre de Miguel Abensour, l’homme est un « animal utopique » toujours capable d’imaginer des mondes différents celui que quelques intérêts et pouvoirs dominants voudraient lui imposer[18]. La naïveté n’est pour autant de mise : nous avons appris que les utopies voisinent souvent avec leurs sombres contraires, anti-utopies et autres dystopies dont, sur le plan littéraire, Aldous Huxley (avec Le meilleur des mondes, 1931) et George Orwell (avec 1984, 1949) furent les précurseurs. A l’heure de l’Intelligence artificielle, la tentation est grande, comme ce fût souvent le cas auparavant, de verser dans les extrêmes : soit pour magnifier les vertus émancipatrices des nouveaux systèmes de traitement de l’information, soit, à l’inverse, pour en dénoncer les usages totalitaires. L’histoire des rêves éveillés en convainc aisément : tout aussi simplistes l’une que l’autre, aucune de ces deux postures n’est satisfaisante pour espérer juger les impacts des utopies sur le monde social.
Dégager les utopies concrètes des plis du social
Depuis quelques années, sous l’effet probablement d’un pessimisme imputable à des orientations politiques toutes dardées d’injonctions à la performance économique et à la soumission institutionnelle, l’esprit utopique fait l’objet d’un nouveau retour en grâce. On en perçoit le souffle dans de multiples luttes sociales contemporaines. Dans le mouvement des places (Nuit debout en France) ou les Zones d’activités à défendre, par exemple, la volonté d’en finir avec les dominations traditionnelles s’affiche plus ostensiblement que jamais avec, pour projet radical, de faire advenir toujours et partout des pratiques imbibées d’autonomie. K. Marx ne s’y était pas trompé qui, en dépit des piques assassines qu’il a pu leur adresser dans des écrits à vocation politique, voyaient déjà dans les utopies de son temps d’authentiques ferments du changement social et, dans les réalisations pratiques que C. Fourier et les autres avaient pu inspirer, la bonne preuve que les songes collectifs peuvent affecter profondément la face du monde[19].
Reste, il est vrai, que nous vivons toujours en eaux troubles. En dépit d’une évolution sur long terme en faveur des mutations techniques, d’une (fragile) démocratisation de la vie politique, de l’amélioration des conditions de vie et plus généralement du progrès social, les insatisfactions demeurent profondes et multiples. L’actualité nous rappelle chaque jour que la propension aux conflits guerriers voisine avec les défaites climatiques, les pressions économiques meurtrissantes ou encore les violences et les inégalités en tous genres. Au cours de ces dernières décennies, les discours et les pratiques utopiques ont évolué à la mesure de ces nouveaux défis. Les « horizons d’attente », pour utiliser le langage de Reinhart Koselleck, se sont soudainement rapprochées des « champs de l’expérience ». Ceci signifie que les utopies équivalent moins que jamais à de naïves rêveries. A l’heure de ce que François Hartog nomme le présentisme[20], elles portent avec elles l’urgence et nécessité de transformer le monde ici et maintenant.
La difficulté est que, dans leur expression communautaire à laquelle j’ai donné ici la préférence, les utopies concrètes restent souvent tapies dans les plis du social. Elles peinent par conséquent à faire tache d’huile. Le sociologue américain Erik Olin Wright a écrit un bel ouvrage à ce sujet. Après avoir recensé quelques innovations politiques et autres bricolages socio-organisationnels à même aujourd’hui d’amplifier le pouvoir d’agir de chacun·e d’entre nous, il a tenté de comprendre de quelles manières ceux-ci peuvent espérer chahuter l’ensemble de la pyramide sociale[21]. Déjà ancien (d’autres, bien avant E.O. Wright, se sont posé la question des modalités de généralisation possible des utopies locales), mais toujours inachevé, ce programme de recherche mérite toujours que l’on s’y consacre, que l’on soit sociologue de métier ou non.
[1] M. Lallement, Un Désir d’égalité. Vivre et travailler dans des communautés utopiques, Paris, Seuil, 2019.
[2] E. Bloch, Le Principe Espérance, Paris, Gallimard, 3 vol., 1976, 1982, 1991. Première édition originale : 1959.
[3] M. Gauchet, « Visages de l’autre. La trajectoire de la conscience utopique », Le Débat, n° 125, 2003/3, p. 112-120.
[4] K. Pomian, « République des lettres : idée utopique et réalité vécue », Le Débat, n° 130, 2004/3, p. 154-170.
[5] L.G. Gauny, Le Philosophe plébéien, Paris, La découverte, 1983.
[6] Pour une présentation de ces différentes expérimentations phalanstériennes, cf. B. Desmars, Militants de l’utopie ? Les fouriéristes dans la seconde moitié du XIXème siècle, Dijon, Les presses du réel, 2010.
[7] M. Lallement, Le Travail de l’utopie. J.-B.A. Godin et le Familistère de Guise, Paris, Les belles lettres, 2009.
[8] M. Lallement, D. Rousselière (eds), « Expérimentations fouriéristes. États-Unis, XIXème siècle », Cahiers Charles Fourier, n° 33, 2022.
[9] E. Swedenborg (1688-1772) est un scientifique suédois converti au mysticisme à la fin de sa vie, et dont les thèses métaphysiques ont connu un certain succès chez les fouriéristes.
[10] On peut penser par exemple au « bellamisme », qui a inspiré quelques communautés utopiques aux États-Unis également, en référence aux idées du journaliste E. Bellamy, l’auteur d’une célèbre utopie intitulée Looking Backward (1888). En opposition aux propositions contenues dans ce livre, le socialiste anglais W. Morris rédige une autre nouvelle utopique, Nouvelles de nulle part (1890), promise elle aussi au succès.
[11] Le mot est inventé par le français Joseph Déjacque, auteur d’une utopie anarchiste, L’Humanisphère, qui paraît en 1899.
[12] Bernard Lacroix, L’utopie communautaire, Paris, PUF, 1981. Seconde édition : 2006.
[13] Bertrand Hervieu et Danièle Léger : B. Hervieu, D. Léger, Le Retour à la nature. Au fond de la forêt… l’Etat, Paris, Seuil, 1979
[14] Catherine Rouvière, Retourner à la terre. L’utopie néo-rurale en Ardèche depuis les années 1960, Rennes, PUR, 2015.
[15] T. Miller, The 60s communes. Hippies and Beyond, Syracuse, Syracuse University Press, 1999.
[16] M. Lallement, L’Âge du Faire. Travail, hacking, anarchie, Paris, Seuil, 2018.
[17] I. Berrebi-Hoffmann, M.-C. Bureau, M. Lallement, Makers. Les laboratoires du changement social, Paris, Seuil, 2018.
[18] M. Abensour, Utopiques II. L’Homme est un animal utopique, Paris, Sens&Tonka, 2013.
[19] K. Marx, F. Engels, Utopisme et communauté de l’avenir, Paris, Maspero, 1976.
[20] F. Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003
[21] E.O. Wright, Utopies réelles, Paris, La découverte, 2017. La première édition originale a paru en 2010.

