Il faut d’abord en finir avec un cliché : les paysans d’autrefois vus comme des bêtes de somme. Asservis à un travail épuisant et répétitif et immuable, arrimés à leur terre, leur hameau ou leur village, leur existence se serait déroulée selon un cycle inamovible : planter, récolter, nourrir et traire les vaches, couper du bois. Leur part d’humanité s’en trouverait réduite. Cette vie – qui ne serait au fond que survie – n’aurait laissé que peu de place au rêve, à la réflexion, à l’innovation et au changement.
Les témoignages dont on dispose montrent le contraire. Enfants, jeunes, adultes, hommes et femmes, tous et toutes avaient des rêves.
Rêves d’enfants
Les enfants sont des enfants. Ils jouent et ils rêvent. « Nous, les gosses, on jouait surtout à des jeux de travail. Nous ne rêvions qu’à être charretier. Avec des cordes, on en attelait un, et puis “oh”, et puis “hue”, l’autre menait avec un fouet », raconte Grenadou.
Toinou, lui, rêvait d’indépendance. Après avoir arraché ses pommes de terre avec Baudouin, ils faisaient une pause, en silence, à l’ombre des pins : « Le regard fixé vers un lointain inaccessible, je rêvais d’un avenir proche où, sans obligations envers quiconque, en travaillant dur, (…) je gagnerais mon pain1. »
L’imaginaire des enfants se limite à ce qu’ils connaissent, c’est-à-dire pas grand-chose. Le monde ne dépasse pas celui de leur village. Cela dit, en 1900, tous les enfants sont allés à l’école. Ils ont appris l’histoire, connaissent leur géographie et rêvent de voyages en regardant les grandes cartes accrochées au mur. Ils écoutent leur professeur raconter Le Tour de France par deux enfants. Et puis, dans la famille ou le voisinage, ils ont entendu parler du fils du voisin devenu marin ou conducteur de train2. Un des oncles d’Henri Pitaud est un « zouave » : l’armée l’a envoyé combattre en Chine. Un autre oncle a participé à la colonisation de l’Algérie. Ils font figure de héros dans la famille. Ce n’est pas un hasard si, plus tard, lui-même s’établira au Paraguay.
Les jeunes gens ont les rêves de leur âge. Les garçons vont bientôt partir au service miliaire : l’occasion unique de voir du pays. Ils vont y faire des rencontres, parfois décisives, qui les marqueront à jamais. Toinou y a rencontré Gabriel Rigaud et ils sont devenus amis. Gabriel lui présentera sa sœur Suzanne, qui deviendra sa femme. Et la belle-mère, qui dirige seule l’usine familiale de ciment, va lui faire confiance et financer ses études d’ingénieur. Certains reviendront à la ferme avec le désir de changer. Dans sa saga Des grives au loup, Claude Michelet raconte l’histoire des Vialhe. Le fils revient du régiment avec des idées nouvelles pour moderniser la ferme, ce qui n’est pas du goût du père. Le fils finira par quitter la propriété familiale pour s’installer plus loin avec sa femme.
Les gars lorgnent aussi sur les filles : les « Marie », « Jeanne », « Germaine » ou « Louise ». L’une a été entrevue un jour de marché, une autre a participé aux vendanges, celle-ci est domestique et travaille à la maison du maître. Les adolescents ont peu l’occasion de se fréquenter. À l’école, ils étaient séparés (il y a l’école des filles et celle des garçons) et, plus tard, le travail à la ferme leur laissait peu de temps libre pour se voir, ce qui entretient les frustrations et les fantasmes3. Si les filles savent que les histoires de bergère et de prince sont des légendes, elles n’en rêvent pas moins de croiser un gars de la ville qui les sortira d’ici.
Rêves d’adultes
Que deviennent les jeunes garçons et les filles nés à la ferme vers 1900 ?
La trajectoire de Marie-Catherine, rebaptisée Mémé Santerre, a été figée très tôt. Née en 1891, cadette d’une famille de treize enfants, elle était déjà au travail à 11 ans : l’été aux champs, l’hiver devant le métier à tisser. À raison de 12 à 15 heures par jour. Soixante-dix ans plus tard, quand Serge Grafteaux a recueilli son témoignage, elle faisait encore le même travail, elle avait alors plus de 80 ans…
Mais la vie de la Mère Denis a été bien différente. Née deux ans plus tard (1893), Jeanne-Marie Le Calvé (de son vrai nom) a quitté la ferme familiale en se mariant à un cheminot. Elle est alors devenue garde-barrière, métier qu’elle a exercé pendant dix-sept ans. Après la guerre, elle a divorcé puis est devenue lavandière (avant que sa vie ne bifurque tardivement, quand une publicité pour la lessive l’a rendue célèbre dans la France entière).
Grenadou a mis les pas dans ceux de son père : il a repris la ferme familiale, une petite exploitation céréalière dans le centre de la France, et l’a fait encore grandir et prospérer. Son père, déjà, avait gravi les échelons : d’abord métayer, il était parvenu ensuite à acheter des terres en empruntant de l’argent.
Pour Pierre-Jakez Hélias, l’école républicaine a été sa planche de salut. Comme d’autres bons élèves, il a bénéficié d’une bourse et s’en est allé faire des études à la ville.
On pourrait penser qu’il s’agit là d’itinéraires d’exception. Mais ce serait une erreur d’imaginer le monde paysan de l’époque comme un monde statique.
Tout d’abord, l’exode rural avait commencé dès le milieu du 19e siècle. En cinquante ans, de 1860 à 1910, la part de la population active agricole avait déjà chuté de 60 à 40 %4 .
Des fils de paysans partaient en ville, d’autres migraient à l’étranger ; certains devenaient artisans, ouvriers, instituteurs, prêtres… Ainsi, Toinou a même vécu un temps de sa plume comme vulgarisateur scientifique.
Pour ceux qui sont restés à la ferme, la vie n’est pas non plus figée dans le marbre.
D’abord parce que la précarité de la condition paysanne obligeait sans cesse à rebattre les cartes. Les mauvaises récoltes successives, les fléaux (le phylloxéra, qui a décimé les vignes) obligeaient certains à se reconvertir dans d’autres cultures quand certains étaient contraints de migrer dans une autre région. Dans la famille, la mort d’une femme en couches ou un accident obligeait à se réorganiser, trouver un second métier…
Mais cette précarité des conditions ne paralysait pas la pensée. Bien au contraire, la lutte pour la survie stimule les rêves, suscite les espoirs et les craintes, pousse à anticiper et réfléchir, innover et s’adapter pour répondre à cette éternelle question : comment va-t-on s’en sortir ?
Le temps des changements
En travaillant aux champs, en menant les bêtes au pré, en mangeant leur soupe, paysans et paysannes ne cessent de penser, ruminer, calculer, rêvasser. Ils ont en tête les jours à venir : demain, aller aux châtaignes ; samedi, c’est jour de marché ; dans trois semaines, c’est le jour des rameaux. Il faudra demander au Jean qu’il prête son cheval pour le labour.
Il faut mettre des sous de côté : « Quand je porte au marché une motte de beurre, ça me fait à peu près dans les quarante sous, calcule Nanette Baudouin. Avec ça, je peux acheter du fil, des aiguilles, des allumettes, un peu de sel et de vinaigre et mettre quelques sous de côté pour quand il me faut un tablier pour moi ou une blouse pour le Baudoin (son mari)5. »
Le père de Grenadou a l’idée d’agrandir son lopin de terre. Il a entendu dire qu’à l’autre bout du village, il y aurait une parcelle à vendre. Il faudra emprunter…
Les projets de plus long terme sont balisés par deux visions opposées : l’angoisse et l’espoir.
L’angoisse car les menaces sont toujours présentes. La sécheresse, le gel, des bêtes malades, une grossesse qui se termine mal, et la misère s’abat sur vous. La misère, c’est la « chienne du monde », comme on dit dans le pays breton. Elle rôde toujours.
Mais chacun nourrit aussi des espoirs de vie meilleure. Les ouvriers agricoles rêvent de mettre de l’argent de côté pour aller s’installer en ville. Les métayers souhaitent pouvoir acquérir leur propre terre et agrandir l’exploitation. Les gens plus âgés reportent leurs espoirs sur leurs enfants. Des enfants, ce sont des bouches à nourrir mais aussi, bientôt, des bras qui viendront vous aider aux champs et surtout vous remplacer quand votre corps sera trop usé. Les enfants seront un jour des « bâtons de vieillesse ».
Le début du 20e siècle est une époque de grande transformation dans le monde paysan : le train désenclave les campagnes6, les machines agricoles (comme la batteuse) font leur apparition, des laiteries et fromageries achètent la production laitière. Les premières générations de paysans instruits par l’école s’intéressent aux techniques nouvelles : la pasteurisation du lait ou du fromage (par chauffage) ou l’utilisation de nouveaux engrais comme les phosphates. C’est aussi à cette époque que les paysans commencent à s’organiser en coopératives, qu’apparaît le Crédit agricole, qui aide à financer les achats. Dans les villages, des paysans modernistes introduisent des innovations, d’autres les observent. Tout cela donne lieu à des interrogations, des spéculations, des jalousies et des résistances. Les discussions sont souvent âpres entre jeunes et vieux. Les jeunes qui vivent sous le joug du patriarche subissent une autorité qu’il leur paraît de moins en moins légitime. Dans son roman La Terre qui meurt (1899), René Bazin raconte l’histoire d’un homme dont le seul fils souhaite se marier à une fille qui ne plaît pas à son père. Le garçon décide de quitter la ferme. Un à un, tous les enfants s’en vont et le vieil homme se retrouve seul. Qui va reprendre la ferme ? Finalement, il la confiera à un ancien domestique de ferme marié à sa fille. L’histoire ne serait qu’une fiction si on n’apprenait, dans le témoignage d’Henri Pitaud, que son parrain a servi de modèle à René Bazin.
L’existence des paysans de 1900 était dure et austère. La vie à la ferme était contraignante et limitait considérablement leurs aspirations et leur liberté. Pour autant, ce ne fut une vie ni immobile, ni déshumanisée. Leurs conditions de vie imposaient même une dramaturgie permanente. Elles furent le ressort de leurs rêves et espoirs, de leurs soucis, calculs et préoccupations quotidiennes. •
Les écrivains et le monde paysan
Les grands écrivains du 19e siècle, les George Sand, Balzac, Zola, ont écrit sur le monde paysan et ont donné du monde paysan, qu’ils connaissent mal, une vision déformée.
Émile Zola a reproché à George Sand sa vision idéalisée des paysans : elle les décrit, dit-il, comme « bons, honnêtes, sages, prévoyants, nobles. En un mot, ils sont parfaits. » Lui ne partageait pas cette vision idyllique des romans champêtres. Son postulat était inverse, sans aucune complaisance : il dépeignait les paysans comme alcooliques, violents, incultes, avides et voleurs7. Mais lui qui mettait tant de soin à enquêter sur son sujet (il est descendu dans la mine avant d’écrire Germinal) a rédigé La Terre (1887) en observant les paysans d’assez loin. Sa connaissance de la campagne se limitait à des sorties lors de promenades dominicales dans les environs de Paris. Guy Robert, auteur d’une thèse sur La Terre, estime « qu’il n’a jamais été en contact suivi avec des paysans ».
Balzac n’a pas fait mieux. Sa Comédie humaine parle essentiellement des gens de la ville et son dernier roman, inachevé, Les Paysans, est truffé de clichés. Pour lui, le paysan est un être « sauvage, proche de la bête, que la société a du mal à rééduquer pour en faire un homme ((Éric Alary, Histoire des paysans français, Perrin, 2016)) ». Quant à Flaubert, il les décrit comme des « êtres lourds et mal dégrossis », et Maupassant n’en dit guère plus de bien8.
Certains écrivains connaissaient mieux leur sujet.
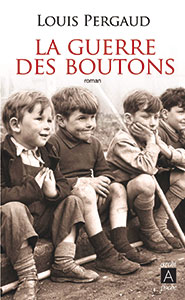
René Bazin vient d’un monde bourgeois mais son roman Le Terre qui meurt reflète bien la réalité. Il en va de même pour Claude Michelet avec Des grives au loup.
Quant à Louis Pergaud, il n’a pas son pareil pour raconter les conflits des jeunes villageois sur le chemin de l’école dans La Guerre des boutons.
à lire
Les témoignages
• Pierre-Jakez Héliaz, Le Cheval d’orgueil. Mémoires d’un breton du pays bigouden, Plon, coll. « Terre humaine », 1975.
• Ephraïm Grenadou et Alain Prévost, Grenadou, paysan français, Seuil, 1966.
• Antoine Sylvère, Toinou, le cri d’un enfant auvergnat, Plon, coll. « Terre humaine », 1980.
• Serge Grafteaux, Mémé Santerre, 1975.
• Serge Grafteaux, La Mère Denis. L’histoire vraie de la lavandière la plus célèbre de France, 1976.
• Henri Pitaud, Le Pain de la terre. Mémoires d’un paysan vendéen du début du siècle, Lattès, 1982. Les sources
Les sources
• Éric Alary, Histoire des paysans français, Perrin, 2016.
• Philippe Madeline et Jean-Marc Moriceau, Les Paysans, 1870-1970, Les Arènes, 2013.
• Jean-Marc Moriceau, Les Couleurs de nos campagnes. Un siècle d’histoire rurale.1880-1960, Les Arènes, 2020.
- Antoine Sylvère, Toinou, le cri d’un enfant auvergnat, Plon, coll. « Terre humaine », 1980. [↩]
- Henri Pitaud raconte l’histoire de son beau-frère, qui utilisait son argent pour acheter des livres d’histoire. Et il a même écrit un livre : L’histoire universelle vue par un simple. Malgré ses talents d’écrivain, il a fini sa vie « comme tout le monde » (dixit H. Pitaud). [↩]
- Jean-Louis Flandrin, Les Amours paysannes, Gallimard, « Folio histoire », 1993. [↩]
- Éric Alary, Histoire des paysans français, Perrin, 2016. [↩]
- Antoine Sylvère, Toinou, op. cit. [↩]
- Eugen Weber, La fin des terroirs. La modernisation de la France rurale (1879-1914), Fayard, 1983. [↩]
- Selon la thèse de Xavier Duyck, « La représentation du paysage agricole dans la littérature française du 19e siècle », 2017 (en ligne). [↩]
- Ibid. [↩]
