Dialogue sur la philosophie, son histoire, ses moments d’essor et de déclin, ses ambitions et ses limites.
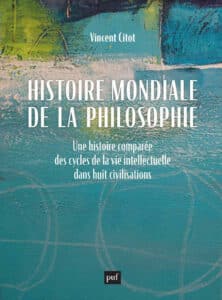 Vincent Citot enseigne la philosophie à l’INSPE de Paris-Sorbonne Université.
Vincent Citot enseigne la philosophie à l’INSPE de Paris-Sorbonne Université.
Il est le Directeur de la revue Le Philosophoire. Il poursuit par ailleurs un travail de photographe plasticien et d’écrivain.
Il vient de faire paraître Histoire mondiale de la philosophie. Une histoire comparée des cycles de la vie intellectuelle dans huit civilisations ( PUF, 2022).
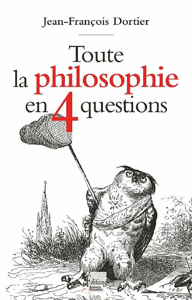 Jean-François Dortier est humanologue.
Jean-François Dortier est humanologue.
Fondateur de la revue Sciences Humaines, il se consacre aujourd’hui à la rédaction de L’Humanologue.
Il vient de faire paraître Toute la philosophie en quatre questions (éd. Sciences Humaines 2022).
Qu’est-ce qu’un philosophe ?
Vincent Citot : Je propose une définition très simple de « philosophe », qui attriste et déçoit tous ceux qui l’entendent (mais je persiste !) : est philosophe toute personne qui passe le plus clair de son temps à philosopher. Bien ou mal, en autodidacte ou en professionnel, en prenant la plume ou en enseignant, dans sa tour d’ivoire ou en parcourant le monde.
On devient philosophe en étant obsessionnel, en quelque sorte. En ce qui me concerne, je harcelais jadis mes parents avec cette question toujours répétée : « Pourquoi ? ». Aujourd’hui, je me harcèle moi-même de la même façon. Au fond, rien n’a changé…
Jean-François Dortier : Tu dis qu’être philosophe, c’est pratiquer la philosophie. Pourquoi pas ! Après tout on désigne comme musicien celui qui pratique assidûment la musique, à titre professionnel ou amateur. Idem pour les peintres ou les cyclistes.
Sauf que cette évidence vaut bien pour aujourd’hui : la philosophie a des contours assez précis et il est facile de distinguer un philosophe d’un écrivain, un physicien, un homme d’Eglise. Le philosophe est aujourd’hui le spécialiste des idées générales qui intervient dans des domaines balisés (éthique + épistémologie, un peu d’idée politique un zeste de métaphysique, pour faire vite).
Mais à l’époque de Descartes ou de Newton, par exemple, la « philosophie naturelle » s’identifiait à ce qu’est aujourd’hui la science. Descartes est autant un mathématicien, physicien (et même anatomiste à ses heures) que métaphysicien. Son projet est celui de forger une « science nouvelle ». Une partie de son œuvre (ex : Discours de la méthode) a été artificiellement isolée d’une autre (géométrie, physique) pour faire de lui notre philosophe national. Même chose pour Aristote. On a isolé des parties de son œuvre (logique, politique, l’éthique, la métaphysique) pour en faire un philosophe en écartant son Histoire des animaux (cinq livres !) qui est pourtant une partie essentielle de sa réflexion.
V.C. : L’identité des « philosophes » varie en effet autant que celle de la « philosophie » – discipline qui n’échappe pas à l’histoire. Tentons d’en donner une définition et nous retrouverons ensuite ton objection sur la variabilité historique des catégories définies.
Qu’est-ce que la philosophie ?
V.C. : Il serait vain de définir la philosophie in abstracto, comme une catégorie qui aurait son essence propre. En réalité, elle est seulement une façon de penser qui se singularise au sein d’une vie intellectuelle déjà constituée. Sa définition doit être relative à ce dont elle se distingue. C’est pourquoi, si l’on me somme de produire une définition courte et claire, je dirais que la philosophie est une pensée religieuse argumentée – donc sécularisée, donc sortie du religieux. Elle se pose en effet les mêmes questions que la religion : de quoi le monde est-il fait ? (et comment le connaître ?) ; qu’est-ce qui a de la valeur ? (sur le plan moral, politique, esthétique, éducatif, etc.) ; comment mener sa vie ? Leurs champs de compétence respectifs, si je puis dire, se recouvrent complètement – si l’on veut des termes techniques : ontologie, axiologie, praxéologie. La philosophie se distingue de la religion par les moyens mis en œuvre pour répondre aux questions qu’elle se pose : argumentation, rationalisation, recours à l’expérience, confrontation critique et autres moyens de justification.
J.-F. D. : La philosophie a certes une identité affirmée aujourd’hui (autour de l’enseignement de la philosophie, ses textes et domaines de référence), mais le fait de se poser des questions sur la nature, sur l’homme, sur le sens de la vie… n’est pas propre à la philosophie. Elle n’est pas qu’une religion laïcisée : elle résulte aussi d’un divorce avec la science.
L’histoire de la philosophie apparaît comme un découpage artificiel et une reconstruction a posteriori dans l’histoire de la pensée savante qui va de la science à la religion ou la pensée politique. L’identité de la philosophie s’est forgée autour d’un socle institutionnel – son enseignement, qui lui-même s’appuie sur un corpus de texte et de thèmes forgés autour d’une « une tradition réinventée », comme disent les anthropologues.
V.C. : Que l’histoire de la philosophie soit, le plus souvent, mal écrite parce qu’artificiellement isolée de son contexte intellectuel (pensée religieuse, morale, politique, préscientifique ou scientifique), je te l’accorde. Que ce que l’on entend par « philosophie » soit relatif à l’historicité de ce contexte, c’est certain. L’apparition des sciences impose à la philosophie de se positionner non plus seulement par rapport à la religion, mais également par rapport à celles-ci.
Tu donnais tout à l’heure les exemples d’Aristote et de Descartes – comment qualifier leurs travaux qui relèvent aujourd’hui de sciences particulières mais qui n’étaient pas, à leur époque, distincts de la « philosophie » ? Dans la mesure où la philosophie prend en charge l’ensemble du savoir avant que les diverses sciences n’en revendiquent leurs parts, je trouve honnête de qualifier de « philosophiques » les études d’astronomie, de physique ou de biologie réalisées par des auteurs ayant vécu avant la grande divergence philosophie-science. Tu as raison de me mettre en garde contre le danger d’anachronisme, mais je ne cours guère de risque en procédant ainsi.
L’un de mes principes historiographiques est d’éviter aussi bien l’anachronisme (notamment la projection artificielle dans le passé de catégories contemporaines) que son inverse, qui consiste à prendre pour argent comptant la façon dont les auteurs du passé ont conçu leur pratique. Le travail de l’historien ne consiste pas à restituer le passé selon la vision du monde en vigueur dans ce passé même. Sinon, il faudrait être animiste pour parler des animistes, aztèque pour parler des Aztèques, etc. Un penseur qui se pose des questions philosophiques est philosophe, même s’il se considère lui-même poète, athlète ou cithariste. Les acteurs de l’histoire ne savent pas toujours l’histoire qu’ils font et ne sont donc pas toujours bons guides pour penser leur propre insertion dans la trame historique. Quand, dans mon Histoire mondiale de la philosophie, je qualifie de philosophe un auteur indien ou chinois de l’Antiquité, je ne fais pas de projection inconsciente artificielle, j’applique un concept en toute conscience de cause.
Quand et où est-elle apparue ? Pourquoi ?
V. C.: La philosophie apparaît quand les réponses religieuses fournies antérieurement ne sont plus considérées comme satisfaisantes, ou bien quand des religieux eux-mêmes sont poussés à argumenter pour faire triompher leurs thèses. Ils deviennent philosophes, parfois à leur corps défendant. Dans les sociétés où ce besoin ne se fait pas sentir, la philosophie n’est pas identifiable comme nouvelle façon de penser. Ce qui ne l’empêche pas d’émerger ici ou là chez des individus singuliers.
Généralement, la philosophie apparaît quand une nouvelle classe sociale revendique une place au soleil du pouvoir contre l’ancienne aristocratie. Sur la base d’un nouveau rapport de forces, elle réforme la politique, le droit, l’administration, l’art et la vie intellectuelle. La philosophie n’est pas étrangère aux enjeux de pouvoir.
J.-F. D. : Je partage bien sûr ton idée que la philosophie, en tant que discipline, naît dans de circonstances sociales et historiques précises. Entrons un peu dans l’histoire.
Il est courant d’affirmer que la philosophie (occidentale) est née en Grèce antique vers le VIe siècle avant J.-C. Il est intéressant de noter que ce n’est pas la Grèce telle qu’on l’entend mais plutôt dans les cités turques. Au moment où Athènes n’est encore qu’une bourgade, fleurit sur la côte turque et les îles voisines une économie prospère. Ce n’est pas un hasard si la monnaie est inventée au même endroit et au même moment, en Lydie, royaume voisin où a régné le célèbre Crésus.
La Ionie est un lieu carrefour où circulent les marchandises et les idées, entre la Mésopotamie et l’Égypte. C’est un peu plus tôt et un peu plus au sud, que les phéniciens, peuple commerçant, inventent l’alphabet (les peuples se rencontrent, les commerçants échangent, rédigent des contrats commerciaux et leur faut une écriture commune). On pourrait dire sans exagérer que la monnaie, l’alphabet, la science et la philosophie ont une origine commune. C’est dans ce contexte qu’apparaissent ceux qu’on appelle aujourd’hui les « philosophes » – mais qui sont tout à la fois savants (fondateurs de la physique), sages, législateurs et moralistes.
En Ionie, se trouve Milet (et ses philosophes Thalès, Anaximandre). Héraclite est d’Éphèse, également en Turquie. Pythagore vient de Samos, au large des côtes turques. Les Éléates se sont installés en Italie du sud, mais viennent de Phocée (encore la côte turque). Tous les philosophes dits « présocratiques » viennent de cette région. Ils sont à la fois savants, législateurs ou conseillers du Prince (à un moment où les cités se dotent de nouvelles constitutions).
Il serait intéressant d’analyser plus en détail comment leur pensée est assez directement reliée aux préoccupations nouvelles de ces élites : une façon d’alimenter une socio-histoire la pensée[1].
V. C.: Ces nouvelles élites représentent, selon les cultures considérées (la Grèce n’ayant pas le monopole de la philosophie dans l’Antiquité), une classe montante de commerçants, administrateurs, législateurs, professeurs, juristes, poètes, etc. Leur point commun est de renouveler, réformer, réviser ou révolutionner les croyances traditionnelles. Le pluralisme s’insère dans les dogmes jadis monolithiques, les rapports sociaux se démocratisent (très partiellement, mais d’une façon néanmoins significative), les échanges se multiplient et la vie intellectuelle se libéralise. Les commerçants, tu as raison de le souligner, jouent souvent un rôle important dans ces bouleversements intellectuello-culturello-politico-socio-économiques. La Ionie en est un parfait exemple.
Mais la philosophie est née dans plusieurs régions d’une façon indépendante – un peu comme la révolution néolithique, qui a connu une demi-douzaine de foyers originaires. Elle apparaît en Inde dès les VIIIe et VIIe siècles dans les Âranyakas et les premières Upanishads et en Chine peu après, dans le sillage des grandes spéculations cosmologiques, numérologiques, morales et politiques des Classiques (surtout le Shu jing et le Yi jing). De ces trois foyers originaires et indépendants s’inspirent les philosophies romaine, islamique, européenne ou encore japonaise. Il serait injuste de n’y voir que des prolongements d’impulsions originaires, car, pour ne prendre que l’exemple de l’Europe, il y eut une rupture assez nette pendant le haut Moyen Âge. Dire que la philosophie du XIe siècle européen est le « prolongement » de la philosophie antique, c’est rayer d’un trait de plume quatre ou cinq siècles. Selon moi, il est plus honnête de parler de renaissance.
Quels sont les grands moments de l’histoire de la philosophie ?
V.C.: Il n’y a pas une histoire de la philosophie, à moins de prendre un recul si considérable sur « la pensée humaine » que les différentes civilisations elles-mêmes apparaissent comme des détails contingents. A regarder les choses à bonne distance, on doit reconnaître qu’il y a des histoires de la philosophie, parce qu’il y a des traditions différentes, culturellement marquées. C’est ce qui rend possible la perspective comparatiste.
Malgré l’hétérogénéité des philosophies grecques, indienne, chinoise, islamique, etc., chacune connaît à peu près le même développement et passe par les mêmes étapes principales, que j’appelle préclassique, classique et postclassique (selon que la philosophie se pratique sous domination de la pensée religieuse, qu’elle en devient indépendante ou qu’elle retombe dans une dépendance nouvelle, vis-à-vis de la science). Finalement, à l’achèvement du processus, science et philosophie disparaissent au profit de la pensée religieuse, qui reste seule en piste. Ainsi, les histoires de la philosophie décrivent des cycles. C’est peut-être désespérant par rapport à l’espoir d’un progrès continu, mais c’est ainsi, il me semble. J’attends que l’avenir me donne tort.
J.-F. D. : Qu’il existe des histoires de la philosophie et non une seule, comment ne pas l’admettre ? Il est bon de le rappeler : oui, la Chine et l’Inde et les terres d’Islam ont leurs philosophes. Que ces histoires suivent des dynamiques d’ensemble, dont on peut étudier la dynamique, voilà un autre point sur lequel nous convergeons. L’approche classique de la pensée en termes d’individus d’exception et/ou d’écoles et courants singuliers a ses limites. Il est bien plus intéressant de les inscrire dans des dynamiques globales et d’en chercher les formes et les causes. C’est tout l’intérêt que je porte à ton Histoire mondiale de la philosophie.
En revanche, que cette dynamique globale épouse des cycles, voilà qui me laisse plus dubitatif. A ce stade, mes doutes sont a priori car j’admets ne pas avoir de vue globale sur l’histoire mondiale de la philosophie pour mesurer la pertinence de ta thèse. Mes points de départ sont différents. Dans le passé, je me suis intéressé à l’histoire des cycles historiques appliquée à l’économie (j’ai rédigé un article de mon Dictionnaire des sciences sociales). Il fut un temps où des historiens de l’économie voulaient de toute force trouver des cycles et vagues. Et ils en ont bien sûr trouvé : des cycles courts (cycle des affaires, des prix) et des plus longues périodes de vaches grasse et maigres, inscrits eux-mêmes dans des longues vagues du capitalisme.
Mais finalement la recherche des cycles a perdu sa pertinence : personne n’a pu inscrire l’histoire longue dans des cycles précis avec une temporalité régulière. Il n’est possible de la faire qu’en donnant au cycle une acceptation très large et donc très vague. Je suis arrivé à peu près aux mêmes conclusions à propos de l’histoire des empires (qui, dans l’optique de Toynbee, ou de Spengler et d’autres déclinistes et effondristes actuels suivent un destin unique – naître croître puis mourir). Ça ne marche pas vraiment pour la Chine, l’Inde ou le Japon.
J’admets que ma critique est externe : elle n’aurait de portée pour la philosophie qu’en entrant dans le vif du sujet et donc à partir d’exemples précis. Par exemple, je suis plus sceptique à propos de la philosophie romaine ou de la philosophie européenne. Mais je laisse cela pour la suite de la discussion.
Personnellement, je vois dans l’histoire de la pensée des trajectoires d’évolution qui n’épousent pas forcément des cycles mais empruntent des dynamiques diverses : feu de paille sans lendemain, longues et lentes évolutions, hybridations, bifurcations, ramifications, ou révolutions en chaîne, etc. Cela vaut, me semble-t-il, pour les espèces vivantes, les empires, les économies ou les mouvements religieux. Comme je suis plus à l’aise pour en parler dans ces domaines (plutôt que la philosophie), je passe donc mon tour avant d’y revenir bien sûr !
V. C.: L’idée de cycle a beaucoup souffert de ses emplois idéalistes (dialectique hégélienne appliquée à l’histoire) ou vitalistes (Spengler voyant les sociétés comme des grands vivants) – sans parler des métaphysiques traditionnelles (hylozoïsme grec, cosmologisme confucéen, cyclicité calendaire maya, etc.). J’essaye pour ma part de ne pas appliquer à l’histoire intellectuelle une idée préconçue de la Cyclicité (inscrite dans le Cosmos, le Logos, l’Être en soi, que sais-je encore…). Si l’histoire était linéaire, cela m’irait très bien. Si elle était chaotique, j’en serais attristé, mais j’en prendrais mon parti. Je la constate cyclique, sans volonté de faire entrer de force le réel dans un carcan métaphysique préalable.
En outre, je ne vois pas des cycles partout, mais seulement quand une dynamique socioculturelle suit son cours sans bouleversements externes. Une invasion ou une catastrophe naturelle peut interrompre brutalement un développement culturel. J’admets aussi, parce que je le constate, qu’il existe en histoire intellectuelle comme ailleurs des feux de pailles, des révolutions ou des stagnations. Il ne faut sous-estimer ni la complexité des choses, ni la régularité des phénomènes. Il est à la fois vrai que chaque vie intellectuelle a ses spécificités et ses ramifications propres, et que son évolution séculaire ressemble aux autres.
D’une façon générale, nous sommes bien obligés d’admettre une certaine forme de cyclicité, dans la mesure où l’on reconnaît qu’une culture naît, s’épanouit et disparaît – ou devient moribonde. Ainsi la Grèce et la Rome antiques, l’Islam médiéval, etc. La question est de savoir si, entre naissance et évanescence, différentes étapes sont identifiables et peuvent être rassemblées dans un schéma évolutif transculturel. Tu as raison de souligner que les cas chinois et indiens sont complexes, car les cultures correspondantes perdurent depuis l’Antiquité. J’ai essayé de montrer que, néanmoins, leurs historicités n’avaient rien de linéaire ni de chaotique. Les ramifications de la vie intellectuelle que tu évoques fournissent justement le critère et le cadre pour penser la cohérence des évolutions socio-historique.
Quels sont les causes des phases d’expansion et de reflux en histoire de la philosophie ?
V.C.: Une société qui se développe culturellement est aussi une société où les gens se spécialisent. Si le même homme fait le pain, la guerre, l’habitat et la morale, nous pouvons applaudir à cette multifonctionnalité (l’homme-couteau-suisse !), mais nous aurons du mauvais pain, des murs fragiles et une morale frustre. Une culture, y compris au plan intellectuel, progresse par la spécialisation, c’est-à-dire au fond par la division du travail.
La philosophie est de meilleure qualité quand elle profite de la multiplication des savoirs et des expériences qu’offre une société ouverte, pluraliste et conquérante (y compris sur le plan géopolitique, hélas). Je ne dis pas que les philosophes d’une période sont meilleurs que ceux qui les précèdent, mais que globalement, la philosophie s’enrichit quand son contexte d’élaboration se diversifie et se complexifie. Pour le reflux, c’est la même chose, en sens inverse : quand une société se ferme, que les échanges se tarissent et que les spécialités meurent, globalement, la richesse de la vie intellectuelle décline. Aucun génie isolé ne peut compenser ce processus.
J.-F. D. : Il y a effectivement une correspondance assez étroite entre les poussées et reflux philosophiques et la dynamique des sociétés. Force est de constater que les grands moments et lieux de l’histoire de la pensée épousent ceux de la puissance économique et politique. La philosophie grecque s’épanouit dans les Cités grecques conquérantes, la philosophie islamique se déploie au temps glorieux des Abbassides. L’humanisme apparaît dans les cités italiennes à la Renaissance, Descartes et Spinoza sont en Hollande au temps de son âge d’or, etc. La philosophie n’est souvent que l’une des manifestations d’un épanouissement culturel plus large, qui concerne les sciences, l’art, l’architecture[2]. Pour le dire brutalement, le savoir et pouvoir font souvent bon ménage.
Mais reste à analyser les liens de causalité précis entre les idées et leur base sociale. La question a été fort débattue à propos des origines de la pensée grecque. Tour à tour ont été évoqués le déterminisme économique, technologique, le rôle des contacts culturels, l’impact de la démocratie. Impossible d’aborder la question en faisant l’impasse sur ces hypothèses et les discuter (ce que faisait déjà Aristote avant d’aborder une question). L’histoire comparative permet aujourd’hui de renouveler la question des « causes » en les appliquant à différents lieux et périodes, de la Chine à l’islam.
Je propose de procéder aussi à une analyse des différents usages des idées philosophiques. Les philosophes grecs, par exemple, ont joué plusieurs rôles dans la Cité. Le philosophe était à la fois un penseur en quête de vérité, qui cherche à comprendre le monde (fonction cognitive), mais il est aussi pédagogue (qui crée des Écoles où est formée l’élite de la jeunesse aristocratique), il est parfois idéologue et conseiller du prince, thérapeute et moraliste (la philosophie comme art de vivre et « médecine de l’âme »). On peut d’ailleurs remarquer que la religion jouera des rôles similaires au Moyen âge.
V.C.: Je m’arrête un instant sur le lien de causalité, que tu évoques, entre les idées et leurs bases sociales. Il me semble aussi faux de dire que l’infrastructure détermine univoquement le contenu des idées que de prétendre que ces idées flottent en l’air sans lien avec les conditions socio-économiques. On ne peut expliquer la doctrine de Platon simplement en faisant une analyse sociologique du milieu où il a vécu. Mais le platonisme comme geste philosophique, orientation intellectuelle et pôle d’attraction des esprits de la première moitié du IVe siècle av. J.-C. s’explique largement par le contexte socio-historique. La façon dont Platon envisage la philosophie est à ce titre significative : il réoriente la pensée dans un sens spéculatif, idéaliste et absolutiste après un demi-siècle d’atomisme, de sophistique et de relativisme ; il manifeste une volonté nouvelle de systématisation et il fonde une Académie. Ainsi, il inaugure l’ère des systèmes et de la scolastique (la pensée en école). Tout cela traduit assez bien les besoins d’une époque bouleversée par la guerre du Péloponnèse, rongée par la peste, bientôt menacée par les Macédoniens et où une classe d’intellectuels se sépare de plus en plus de la « populace ». L’orientation intellectuelle de Platon reflète tout cela ; mais, certes, nul ne saurait déduire la philosophie platonicienne des conditions matérielles.
Le même genre d’analyse (ici très schématique, j’en conviens), peut être faite pour tous les grands courants intellectuels à toutes les époques et dans toutes les cultures. En un mot : pas de causalité linéaire et pas non plus de pensée désincarnée. Nous sommes toujours de notre temps, ne serait-ce que parce que c’est lui qui nous invite à aborder telle ou telle question.
J.-F. D. : Ta réponse sur la cause de la philosophie (pourquoi et comment est née la philosophie) me laisse sur ma faim. D’abord, faire de la philosophie un produit de la division du travail me paraît très insuffisant. La division du travail était déjà très poussée en Egypte en Mésopotamie, dans l’empire perse (en Astronomie, en médecine, architecture) sans qu’y naisse une pensée philosophique.
Pour moi, étudier la causalité, ne consiste pas à repérer les bases sociales de la pensée de Platon, par exemple (à la manière marxiste), ni, à l’inverse, à présupposer une autonomie de la sphère des idées (comme une histoire idéaliste des idées), ni même à rechercher une position intermédiaire (une « autonomie relative des idées »). La question des causes renvoie à une enquête large sur l’émergence d’une forme de pensée (distincte et parfois entremêlée à la religion ou de la science). Il s’agit de comprendre comment émerge un type de pensée, ses domaines (l’éthique, la nature, la métaphysique, la politique, l’épistémologie) et ses raisons d’être (quel sont les usages de la philosophie ?).
Concrètement, cela revient à présenter plusieurs hypothèses, les confronter et en mesurer leur pertinence. A ce propos, les historiens des idées ont produit un riche matériau d’étude sur le sujet. La naissance de la philosophie grecque a été attribuée à des facteurs proprement cognitif (le passage du mythe à la raison), économique (la puissance des cités), culturelle (l’interfécondation des cultures politiques), ou liés à l’organisation politique (le débat critique autour des législations des cités, etc. – G. Lloyd les passe en revue dans Origines de la science grecque). Un tel travail me semble nécessaire pour comprendre la dynamique de la pensée.
V.C.: Etudier les éventuels conditionnements sociaux de tel ou tel courant de pensée n’empêche nullement de s’interroger sur les origines de la philosophie comme mode de pensée nouveau (ce à quoi tu m’invites). La recherche des causes trouve au moins deux débouchés, qui ne s’excluent pas l’un l’autre.
Pour expliquer l’émergence de la philosophie ici ou là, on peut invoquer des causes prochaines ou lointaines. Ces dernières sont les mêmes que celles de l’émergence et de la spécialisation d’un réseau intellectuel : il faut que des bourgeois (des habitants de bourgs) mangent à leur faim et qu’ils puissent échanger leurs idées contre salaire ou subvention. Il faut donc qu’une économie agricole soit assez productive pour qu’émergent des villes, etc.
Je passe aux causes immédiates, qui nous intéressent plus spécialement. Pourquoi la philosophie est apparue en Grèce, en Chine, en Inde puis en Islam, et pas en Mésopotamie ou en Egypte (autant qu’on puisse savoir) ? Parce que davantage qu’en Mésopotamie et en Egypte, la Grèce était divisée en cités concurrentes, la Chine en « Royaumes combattants », l’Inde gangétique du VIe siècle en unités politiques et en sectes dissidentes, et l’Islam en factions ou écoles rivales. Ces unités (politiques, économiques ou religieuses) étaient en concurrence, y compris sur le plan intellectuel. Les clercs, les conseillers du prince ou les penseurs en général qui les représentaient ou qui voyageait d’une cité à l’autre devaient hisser leur niveau de raisonnement pour se maintenir à l’avant-garde.
L’émergence de la philosophie au sein d’une pensée religieuse s’explique par la stimulation, la concurrence et les échanges intellectuels. Ce qui suppose division, pluralisme et diversité – qui ont manqué (dans une certaine mesure) en Mésopotamie et en Egypte antiques. Quand le clergé n’est pas remis en question et qu’il domine sans partage la vie intellectuelle, il n’y a pas de raison qu’il se mette à complexifier, rationaliser ou justifier sa vision du monde.
Y a-t-il un progrès de la philosophie ?
V.C.: Si l’on met de côté l’ère industrielle, qui met à l’épreuve le modèle cyclique, l’histoire des civilisations a toujours été une succession de progrès-apogées-déclins. Or l’histoire de la philosophie épouse les courbes de l’histoire générale. La philosophie romaine, par exemple, a commencé par n’être qu’une importation de la philosophie grecque, puis cette dernière a été activement romanisée, avant que l’attrait de l’Orient ne s’impose graduellement à tous les esprits. J’estime qu’il n’est pas absurde de parler de « progrès » quand la philosophie s’extirpe de la pensée religieuse pour affirmer un nouveau mode de rationalité. Il n’est pas non plus absurde de parler de « déclin » quand, après plusieurs siècles de querelles scolastiques et de syncrétisme (c’est-à-dire d’appauvrissement de la créativité intellectuelle), elle retourne à la religion.
Si l’on prend un énorme recul pour considérer l’histoire humaine par-delà la division en civilisations, alors on peut dire que la pensée suit une pente ascendante (car une civilisation ne meurt pas sans léguer des savoirs et des savoir-faire, qui profitent aux civilisations ultérieures). Depuis le Paléolithique, nous sommes infiniment plus savants, par exemple. Or connaître fait partie des ambitions essentielles de la philosophie. Sur le plan cognitif, le progrès est très net. Sur le plan des valeurs, ça se discute.
J.-F. D. : Qu’il y ait un progrès général dans l’histoire de la philosophie lié aux transferts de savoirs d’une civilisation à l’autre, j’ai presqu’envie d’y croire. Mais cela pose immédiatement une série de questions. Pour déterminer un progrès il faut établir un critère servant d’étalon de mesure. Lequel ? Le nombre et la variété des connaissances (mais dans quel domaine ?) ; la rigueur du raisonnement (mais a-t-on progressé en la matière entre la scolastique du Moyen Âge et la philosophie analytique actuelle ?). Et pourquoi pas un progrès vers la « Vérité » (entendu comme adéquation entre la pensée et le monde) ?
Il est certain que dans certains domaines, nous sommes mieux informés et armés théoriquement (et donc plus « intelligents ») que les philosophes du passé. En matière de philosophie de l’esprit, par exemple, depuis Kant et la Critique de la raison pure, sont apparue une philosophie des sciences (très fertile), une philosophie de la perception, les sciences cognitives et nouvelle philosophie de l’esprit. Elles offrent un riche panel d’arguments et de modèles pour penser la pensée ou les rapports entre la pensée et le réel[3].
Fixer un progrès suppose de distinguer les différents publics et usages de la philosophie. Comme pour le marathon ou le Bac : il peut y avoir une baisse moyenne de niveau général (liée à la massification) et une élite de plus en plus performante…
L’idée d’un progrès suppose même qu’on puisse classer les œuvres philosophiques en fonction de leur avancée et pourquoi pas établir un palmarès des plus pertinentes ! J’ai alors envie de savoir : qui sont les philosophes ou les livres dans le peloton de tête ?
V. C.: Avec ta remarque sur les critères, tu mets les pieds dans le plat, c’est-à-dire le doigt sur la difficulté. Je ne crois pas qu’il existe de critère absolu, pas plus qu’il n’y a de valeur en soi. Chacun peut choisir de privilégier tel ou tel critère, décider de valoriser ceci ou cela. Pour un anti-intellectualiste, le silence sera même préférable à la philosophie. Il n’y a pas de bonne raison d’aimer la raison ; l’amour, le désir et les valeurs sont antérieurs. Donc personne n’a tort, sur un plan absolu, de préférer Platon à Démocrite, la Bible aux Essais de Montaigne, et même d’aimer dormir plus que penser. Quand je parle de progrès, je ne me situe pas sur un plan métaphysique général, où le relativisme semble indépassable.
Mais le relativisme (négation de l’Absolu) n’est pas le nihilisme (affirmation du néant et de l’égale inanité des valeurs). Le relativisme peut être et doit être hiérarchique[4] : il n’y a pas de Bien/Vrai/Juste/Beau en soi, mais il y a du plus ou moins bien/vrai/juste/beau relativement à telle ou telle perspective. Si quelqu’un s’engage dans un raisonnement, c’est qu’il valorise implicitement la raison, et donc l’illogisme sera une faute relativement à son engagement.
J’en viens à la question du progrès en philosophie. Dès lors que l’on valorise la connaissance, la raison, la recherche du vrai, alors oui, il y a du plus ou moins pertinent, du plus ou moins savant, du plus ou moins justifié. Il n’y a pas de progrès en philosophie du point de vue de Sirius, mais il y a un progrès concevable dès lors que l’on se donne le savoir comme valeur. Et avec le savoir, les instruments du savoir, c’est-à-dire des outils de décentration (rationalisation, cohérence, argument, justification, expérience, conceptualisation, théorisation, etc.).
Penser, c’est donner à l’activité pensante une valeur. Il y a donc de l’éthique, en un sens, au cœur de toute pensée philosophique. Ainsi, la philosophie morale n’est pas non plus condamnée au nihilisme. Mais d’autres critères immanents permettent de hiérarchiser les philosophies morales et politiques, comme de savoir si elles servent ou desservent les causes qu’elles prétendent défendre. Quand une philosophie politique fait des propositions contreproductives par rapports aux fins qu’elle pose, souvent parce qu’elle néglige l’étude des moyens, on peut et on doit la juger en conséquence.
Quels liens entretient la philosophie avec les autres types de savoirs / pensées ?
V. C.: Avec les autres types de savoirs et de pensées, la philosophie entretient des liens d’engendrement, de collaboration puis de concurrence. Dans les périodes préclassique et classique, la philosophie permet aux différentes disciplines du savoir de se constituer, car celles-ci naissent souvent de celle-là (pas toujours, certes). Les spécialités philosophiques deviennent des sciences indépendantes. Après quoi, une certaine collaboration peut prendre place : la philosophie se ramifie encore en nouvelles spécialités (donc de nouvelles idées), tandis que les savoirs positifs autonomes enrichissent la philosophie par un apport cognitif continu. Finalement, quand la science s’impose à l’avant-garde de la vie intellectuelle, la philosophie se sent menacée (en partie à juste titre) et se place dans une posture de défiance, de critique, de réaction. Elle devient intellectuellement réactionnaire, en somme.
J.-F. D. : Si on admet que philosophie, religion et science se fixent comme objectif commun d’expliquer le monde, il est alors possible d’étudier leurs domaines du savoir respectif, les liens, transferts. Il est même possible de discuter de leurs valeurs respectives à l’aune du savoir. Et sur ce plan, il n’y pas de doute : la science triomphe. A la question « pourquoi le ciel est bleu », les religions apportent leur réponse (les dieux l’ont voulu ainsi), la philosophie est ignorante, la science seule apporte une réponse solide (la diffraction des ondes lumineuses dans l’atmosphère).
Mais la religion ne se résume évidemment pas à une quête de savoir. Dans l’histoire, ses fonctions ont été autant cognitives (expliquer le monde), législatives (fixer loi et morale commune), existentielles (proposer un salut et un sens à la vie), sans parler de ses rôles thérapeutiques (la guérison) ou politiques[5].
Voilà comment je vois les choses. La philosophie (en Occident) a toujours assumé plusieurs rôles. En Grèce antique, le philosophe se voulait « l’ami de la sagesse », c’est-à-dire savant (celui qui sait) et sage (celui qui donne mène une vie digne). Dans les faits, elle recoupe plusieurs domaines : la physique (ou s’illustre l’école de Milet, les atomistes), les mathématiques (où s’illustrent les pythagoriciens), l’éthique, (domaine de prédilection des stoïciens, épicuriens), la politique (Platon et sa République). Il n’y a pas de frontières étanches entre ces domaines, car la plupart ont joué sur plusieurs tableaux. Reste que le profil d’un Socrate (qui se moque des « physiciens ») est aussi très différent d’un Aristote (dont la visée est essentiellement scientifique).
Au Moyen Âge, la pensée est entièrement absorbée par l’Eglise. Du coup, une grande partie de la philosophie s’est faite théologie. A partir de la Renaissance, la philosophie et les sciences (qui forment alors un tronc commun) s’émancipent progressivement de la tutelle de l’Eglise. Puis, à partir du XIXe siècle, ce sont les sciences qui prennent leur autonomie, se spécialisent et s’affranchissent d’une philosophie spéculative. Au XIXe siècle, ce sont les sciences humaines qui se séparent de la philosophie.
Du coup, la philosophie se trouve dépouillée d’une grande partie de ses domaines d’élection. L’éthique et la métaphysique étant largement discréditées au XIXe et XXe siècles, elle se consacre surtout à étudier sa propre histoire et faire l’exégèse des auteurs canoniques. Il lui reste quelques domaines en propre comme l’épistémologie pour se distinguer. Pour le reste, elle devient surtout une discipline d’enseignement ou une tribune publique où elle trouve à l’illustrer.
V.C.: Je souscris à tes analyses, à ceci près que la dissociation philosophie-science n’a pas eu lieu qu’en Europe moderne, mais aussi dans bien d’autres civilisations. En Grèce antique, par exemple, Hippocrate et son école marquent une première rupture entre la façon de faire des philosophes et celle des savants. Mais c’est surtout à l’époque hellénistique que le clivage se creuse, quand Athènes demeure le centre de la vie philosophique, tandis qu’Alexandrie devient un pôle de recherches scientifiques indépendant.
Je te trouve un peu sévère avec la philosophie contemporaine, même si j’apporte moi-même de l’eau à ton moulin, en montrant les tendances scolastiques et sclérosantes de la philosophie universitaire. Reste que cette philosophie est elle-même diverse et en évolution constante. En outre, il existe une philosophie hors de l’université qui n’est pas négligeable. Les scientifiques eux-mêmes se prêtent volontiers au jeu de la philosophie, quand ils réfléchissent aux conséquences morales, politiques et existentielles de leurs travaux. Ce n’est plus une philosophie de philosophes, mais c’est tout de même de la philosophie[6].-
Qu’est-ce qu’un philosophe aujourd’hui ?
V.C.: Aujourd’hui comme jadis, un philosophe est un individu qui fait de la philosophie son activité principale. Mais comme nous venons de le voir, les diverses sciences ont grignoté le terrain cognitif de la philosophie, de sorte qu’un philosophe contemporain ne peut plus avoir pour objet d’étude les étoiles, la matière, le vivant, etc. – ou alors d’une façon qui n’est plus seulement gnoséologique. Certes, il est toujours possible, pour les philosophes, de susciter la naissance de nouvelles spécialités et d’élargir tel ou tel champ du savoir. Mais globalement, la charge d’accroître les connaissances n’est plus sa tâche essentielle. Celle-ci serait plutôt de réfléchir aux avancées scientifiques et de les coordonner avec les questions morales, politiques, juridiques et existentielles.
J.-F. D. : Le philosophe aujourd’hui ? J’ai failli répondre : une âme perdue pour le progrès du savoir. Mais c’est peut-être exagéré… En fait, je vois plusieurs cas de figure.
- Le professeur de philosophie : il enseigne les classiques et fait réfléchir ses élèves à des questions insolubles, du genre : « est-il raisonnable d’être juste ? », « l’art peut-il changer le monde ? » – questions auxquels personne n’est vraiment armé pour répondre.
- L’intellectuel : la France en fabrique à la pelle depuis Voltaire. Ce sont souvent des donneurs de leçons, qui se trompent souvent mais assurent le spectacle des idées.
- Le chercheur : spécialiste d’histoire de la discipline (Leibniz ou Spinoza) ou spécialiste d’un domaine (philosophie des sciences, de l’esprit, de l’éthique médicale). Il y même des spécialistes des séries télévisées.
Le cas des maîtres à penser (Jacques Derrida, Michel Foucault, Alain Badiou ou Paul Ricoeur) m’interrogent. Ce sont des producteurs de théories et concepts qui séduisent pour leur capacité à voir le monde sous un nouvel angle. Mais que nous apprennent-ils/elles de vraiment pertinent ? La « Déconstruction » de Jacques Derrida (il faut se méfier des catégories de pensée), d’accord ; mais son œuvre est très bavarde pour dire cette chose simple. Michel Foucault ? Le savoir est un pouvoir, la « biopolitique ». Oui, mais les historiens pourraient le dire aussi bien, plus clairement (et en se trompant un peu moins sur les faits[7]). Deleuze et Guattari et la philosophie des réseaux. Ça (me) parle… Donc pourquoi pas ?
Mais honnêtement je me dis souvent que la philosophie agite dans l’ensemble beaucoup de neurones pour un résultat assez maigre. Un peu comme le vélo d’appartement : on transpire beaucoup mais sans avancer d’un centimètre.
V.C.: Je suis philosophe de formation et de profession, mais je n’ai pas l’habitude de prêcher pour ma boutique (j’estime même lui rendre service en critiquant ses produits) ; donc ne compte pas sur moi pour modérer ton propos. Je reproche pour ma part deux choses symétriques à la philosophie contemporaine : d’avoir un rapport ambigu aux sciences (défiance, surplomb, contrefaçon, mimétisme[8]) et un rapport désincarné à l’existence (on refait le monde en idées, mais on mène sa vie d’une façon déconnectée de ses principes). Quand la philosophie devient une profession et une spécialité, elle tend fatalement à se couper des autres disciplines (autres problèmes, autres carrières) et de la vie (on est philosophe de telle heure à telle heure, puis la vie reprend son cours imperturbablement).
Ceci dit, depuis 1980 environ, le rapport aux sciences est pacifié (l’interdisciplinarité est à la mode) et depuis une quinzaine d’années, le retour du militantisme (justice sociale, féminisme, écologisme, décolonialisme) a rapproché la philosophie universitaire des préoccupations axiologiques et existentielles (au détriment de l’histoire de la philosophie, qui était devenue une pure scolastique). Donc la situation évolue. Je ne crie pas victoire, néanmoins, car les sciences sociales avec lesquelles les philosophes aiment collaborer sont très idéologisées, et la philosophie des valeurs prend surtout la forme d’une politisation de la philosophie.
Quoi qu’il en soit, je me reconnais dans ta typologie du philosophe-professeur, philosophe-chercheur, philosophe-intellectuel et philosophe-maître penseur[9]. J’ajoute que beaucoup de gens, qui ne sont pas philosophes stricto sensu, font de la philosophie à leurs heures : des savants, comme je l’ai dit tout à l’heure, mais aussi des écrivains, des journalistes-éditorialistes, des politiques, des artistes et des honnêtes hommes cultivés. Les philosophes détestent généralement ces philosophies de non-philosophes, qui n’intègrent pas les codes ni le jargon des professionnels.
[1] Sur le sujet, j’ai essayé de montrer dans le dernier numéro de L’humanologue (N°8, « Les cités du savoir ») combien l’histoire de la pensée était étroitement liée aux grands foyers de la puissance (économique et politique).
[2] J’ai tenté de faire un panorama des liens entre la pensée et la puissance dans l’histoire de l’Occident dans « Les cités du savoir » L’humanologue, n°7.
[3] Je lis par exemple dans le dernier numéro de La Recherche un article sur la philosophie de la physique quantique (en gros, les modèles représentent-ils le réel ou sont-ils de pures constructions de l’esprit ? Après avoir passé en revue les positions en présence : l’auteur conclut : « Le débat philosophique autour de la question du réalisme scientifique a nettement progressé grâce à une meilleure définition des concepts et des arguments. C’est ce qui permet aujourd’hui d’éliminer les positions les plus naïves au profit proposition plus élaborée concernant les rapports complexes contre tiennent nos représentations la réalité » (« Les multiples nuances du courant réaliste », Q. Ruyant, in La Recherche, Dossier « Le réel », Oct. 2022).
[4] Je m’en explique dans Le paradoxe de la pensée (Le Félin, 2010) et dans Puissance et impuissance de la réflexion (Le Cercle Herméneutique, 2017).
[5] Dans L’humanologue n°2, « Pourquoi Dieu existe encore ? », dans Sciences Humaines (Qu’est-ce qu’une religion ? »), dans Le livre Les religions, des origines au 3ème millénaire, (co-dirigé avec Laurent Testot), j’ai essayé de résumer quelques grandes fonctions des religions aux cours de l’histoire.
[6] Cf. « La philosophie des philosophes et celle des autres – en quoi consiste la seconde et comment l’historien de la philosophie doit la prendre en charge », Le Philosophoire, 52, 2019.
[7] Je m’en explique dans De Socrate à Foucault, Les philosophes au banc d’essai (2018).
[8] Ce qui correspond à ma typologie de la philosophie comme anti-science, méta-science, para-science ou simili-science (Histoire mondiale de la philosophie, chp. 4, III-1).
[9] J’avais tenté une catégorisation assez proche, en distinguant les techniciens (notamment les chercheurs), les théoriciens et les praticiens (intellectuels engagés, éducateurs, etc.) – cf. « Essai d’évaluation de la production philosophique contemporaine », Le Philosophoire, 47 (2017).

J’ai particulièrement apprécié la formule « une pensée religieuse argumentée ». Perso, je réduis la philo à la métaphysique mais ça veut dire la même chose. Je regarde avec amusement tous ces penseurs que la télévision appelle « philosophes »: les amis du climat, les défenseurs des animaux. Mais j’ai tort. Ce sont des religieux, souvent rationnels, des Saint Thomas en quelque sorte, des philosophes donc. Il y a quand même un hic: peut-on faire religion sans transcendance ? Parce que Gaia elle-même ne peut la revendiquer. Mais ma question tient peut-être au fait que nous avons oublié le paganisme depuis plus de 1000 ans. Son grand retour nous permettrait de réfléchir non sur la méta mais sur l’intra-physique. Et accessoirement de lire autrement et un peu mieux Platon et Aristote…
Un beau programme !
Encore un texte qui m’intéresse, surtout parce qu’il tourne autour de définitions difficiles à formuler. Ci-joint mes réflexions.
Philosophe. V .C « est philosophe toute personne qui passe le plus clair de son temps à philosopher. »
MK : Oui, mais on peut philosopher par intermittence, en lisant les bons auteurs mais aussi et surtout en participant à des discussions, en ne restant pas cloitré dans sa chambre, près de son poêle. Philosopher c’est fondamentalement une activité orale, une construction collective au cours d’un café-philo, d’un banquet ou d’un séminaire.
JF.D : « Le philosophe est aujourd’hui le spécialiste des idées générales »
MK : Oui, les philosophes apprécient les idées générales, ils ont tendance à les préférer aux faits (encore une différence avec des sciences), c’est une facette de leur refus de toute contrainte. Et négliger les faits a aussi l’avantage de ne pas être tenté de les sélectionner, d’écarter ceux qui dérangent nos idéologies…mais ils ont quand même la peau dure.
Philosopher. V.C : « [poser] cette question toujours répétée : « Pourquoi ? »
MK : Oui c’est poser des questions qui concernent le pourquoi plutôt que le comment (domaine des sciences) c’est à dire traquer le sens, ne pas exclure les causes finales, mais à condition de bien formuler ses questions et de bien argumenter ses réponses.
La quête de sens est exprimée dans cette belle citation :
« Problématiser est éthique. C’est prendre la responsabilité du monde pour lui donner de la question et du sens. C’est oser se laisser déranger, déstabiliser, rendre vulnérable par lui. La philosophie est spéculative, elle est un miroir (speculum) dans lequel toute la réalité et l’histoire se voient. La philosophie opère un renversement, elle réfléchit le réel pour le penser et lui donner du sens. … À travers la problématisation, l’homme prend en main le réel, il le voit, il se l’approprie et il lui donne un sens. »
Nathalie Frieden L’émergence de la problématisation. Diotime, n°73, 07/2017.
La définition que je préfère : philosopher c’est essentiellement s’efforcer de penser sans contraintes autres que celles de la raison. En particulier sans les contraintes idéologiques que V.C. a signalées à juste titre en évoquant l’entrisme des idéologies dans les sciences humaines et dans la discussion philosophique.
Philosophie. V. C. : « Une religion argumentée, donc sécularisée. »
MK : NON, ce n’est pas une religion, même sécularisée. Toutes les religions sont d’ailleurs argumentées. Les religions, selon moi, sont des idéologies, des édifices conceptuels qui donnent un sens à notre existence et au monde. Les idéologies religieuses, politiques ou laïques, donnent des réponses définitives, elles produisent fréquemment des dogmes, alors que les philosophies restent ouvertes à la discussion du simple fait de la pratique philosophique, de l’acte de philosopher centré sur le questionnement et le raisonnement.
Les idéologies, que l’Humanologue a passées en revue, ont la vertu de calmer notre angoisse existentielle, et les idéologies religieuses sont probablement les plus efficaces pour soulager ce type de souffrance. Leur efficacité résulte toutefois plus de l’effet placebo que d’une action réellement curative sur les causes de l’affection.
Où placer la philo dans les grands types de connaissances ?
Si la philo ne trouve sa place ni dans les magies (toujours actuelles), ni dans les idéologies politiques, religieuses, laïques, ni dans les sciences, même les sciences humaines, c’est peut-être qu’elle a pour fonction principale d’être un réservoir de pensées nécessaire à l’économie générale des connaissances.
Le corpus philosophique est effectivement un réservoir hétéroclite et inépuisable de pensées essentielles et signifiantes. Quel énorme réservoir ! Quelque chose comme la Bibliothèque de Babel imaginée par Borges. Un réservoir sans cesse alimenté par de nouveaux apports qui trouvent une résonnance immédiate avec les questionnements de la société du moment ou qui attendent très longtemps avant d’être exhumés et médiatisés. Les idéologues en font leur boite à outils, ils sélectionnent les valeurs éthiques et des fragments de théories qui leur conviennent pour construire leurs idéologies collectives et politiques ou réparer leurs défaillances. Et nous aussi, humbles lecteurs des maîtres philosophes, nous grapillons dans leurs écrits de quoi alimenter notre idéologie personnelle.
Quelle fonction sociale pour les philosophes aujourd’hui ?
Les philosophes professionnels sont des diffuseurs de la philosophie académique, celle de l’écrit. Ils puisent leur inspiration et la matière de leurs œuvres dans le réservoir philosophique et ils traduisent en langue commune des concepts et des théories exprimées dans un jargon incompréhensible à la majorité des lecteurs. Ils le font généralement bien et c’est pourquoi je vais lire le livre de Vincent Citot avec le même plaisir que j’ai eu à lire les livres de J-F. Dortier.
Ils doivent aussi nous apprendre à philosopher, à participer à la discussion en groupe pour échanger des idées sans autre enjeu que le plaisir de chercher des réponses provisoires aux questions existentielles qui nous obsèdent. Le besoin de philosopher est énorme, probablement plus fort que celui de lire ou d’écouter des philosophes parler comme dans les livres. Il s’est manifesté sur les ronds-points où les gilets jaunes se réunissaient pour « refaire le monde » et la meilleure preuve qu’il s’agissait bien de discussion philosophique c’est l’échec des tentatives de récupération idéologique d’un mouvement populaire sans maître à penser. Le rôle social des philosophes n’est pas seulement d’enseigner une histoire comparée des philosophies, c’est également d’enseigner la pratique de la discussion philosophique. La discussion philosophique en groupe n’est pas une simple conversation ni un débat (un combat) pour affirmer son point de vue et convaincre un adversaire, ce qui serait une posture idéologique. Elle nécessite un climat de bienveillance propice à l’écoute des intervenants ; il faut adopter des règles pour gérer le temps de parole ou pour faciliter la compréhension des interventions. Mon expérience des quelques cafés-philos auxquels j’ai participé m’incite à placer les animateurs de ces groupes parmi les philosophes ayant la plus grande utilité sociale aujourd’hui. Lorsqu’un café-philo fonctionne correctement, les participants peuvent avoir l’impression d’entrevoir la béatitude que Bento fixe comme objectif à la philosophie.
Cher Michel Khalanski. Merci pour votre copieuse contribution à notre débat !
Approche de la philosophie à 50 ans
J’ai 73 ans et fais partie de ceux et celles qui n’ont pas le « jargon » du , de la philosophe mais je me « votre » avec « délice » dans cette pensée et à fortiori dans ce que je viens de lire .
Merci infiniment !